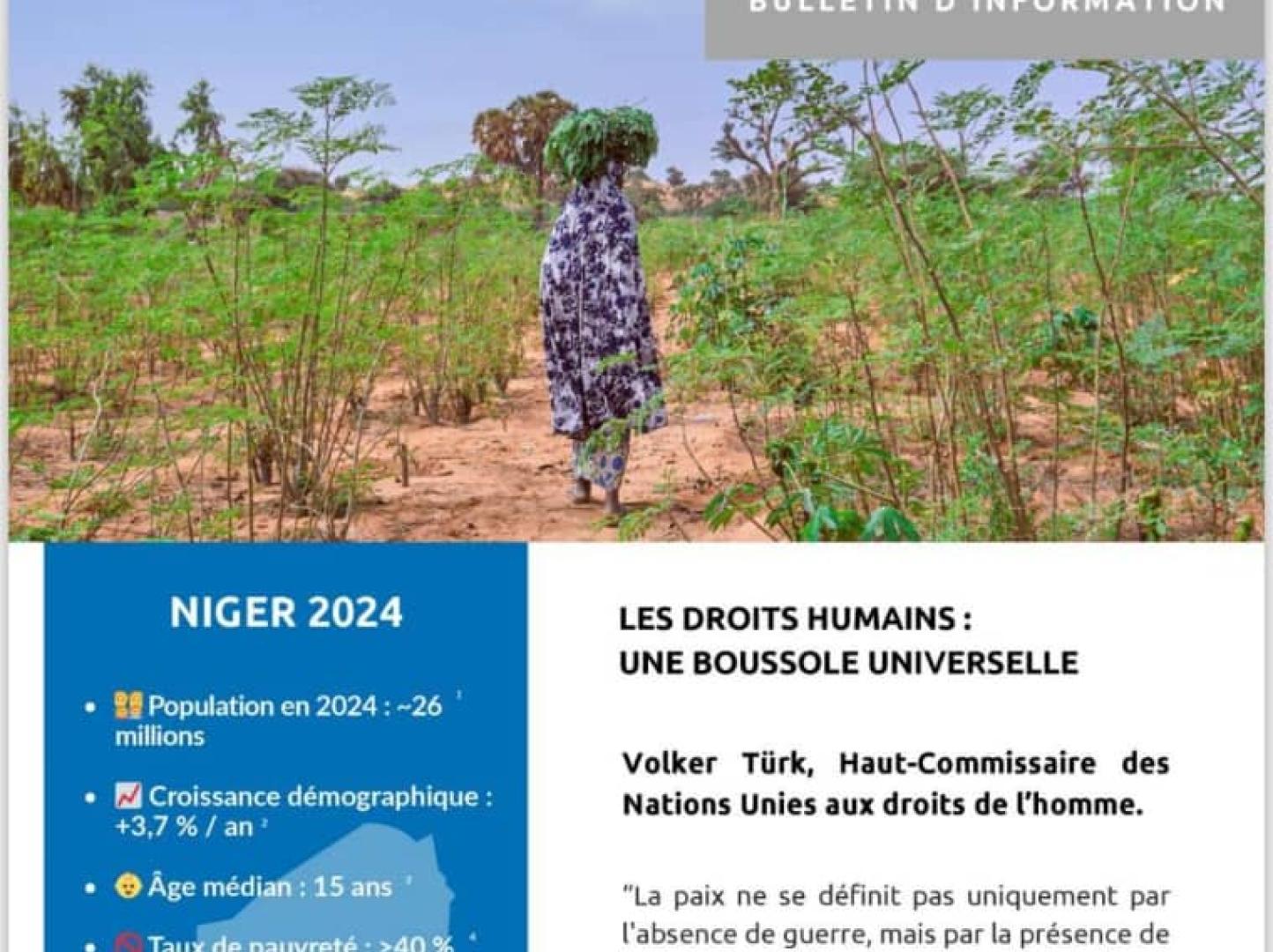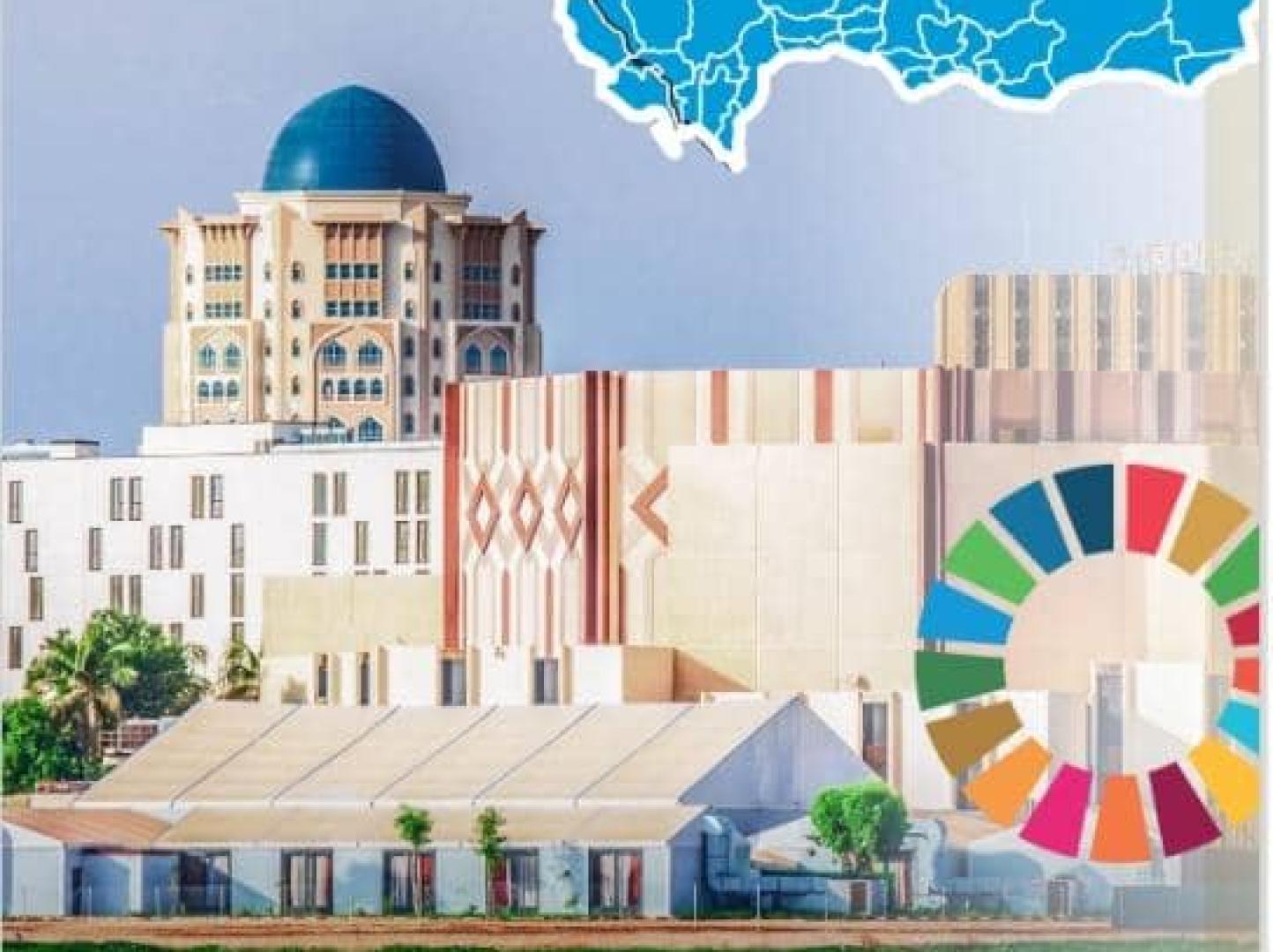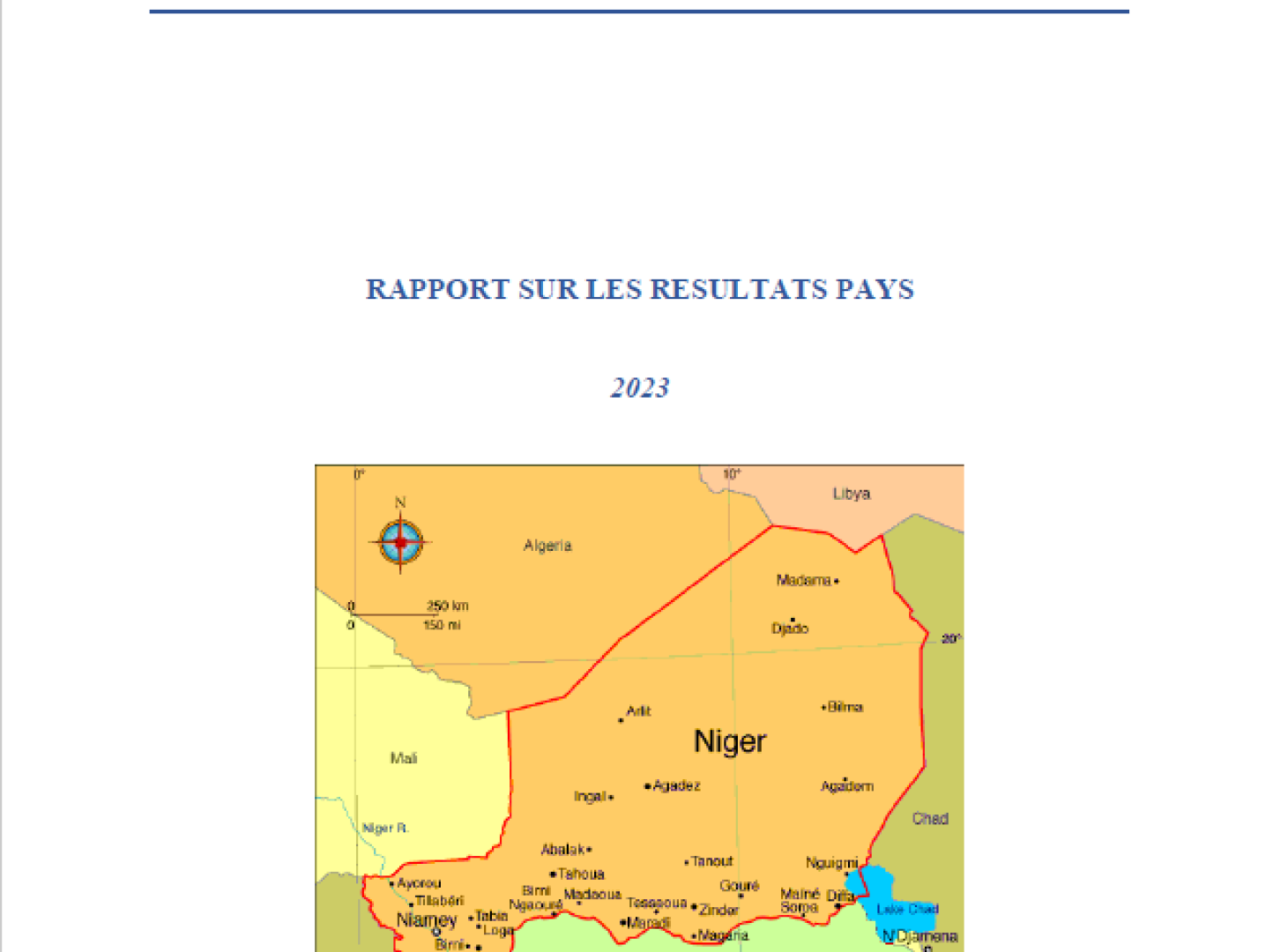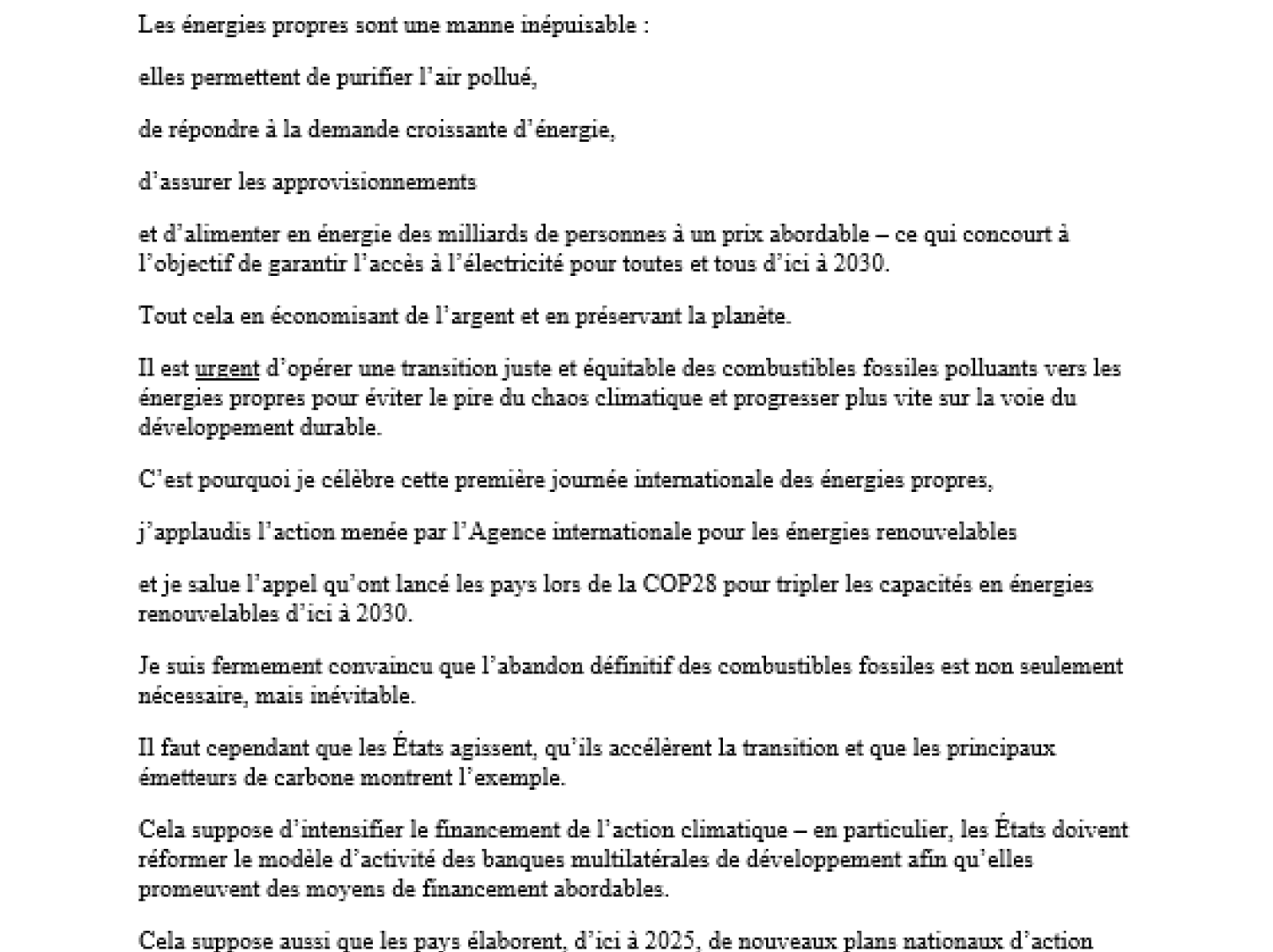Dernières actualités
Histoire
14 juillet 2025
Sani, volontaire au service de la restauration des écosystèmes pour le bien-être des communautés
Pour en savoir plus
Histoire
10 juillet 2025
Consolider la paix face aux changements climatiques : le PBF et ses partenaires à l’écoute des communautés de Tahoua
Pour en savoir plus
Histoire
27 juin 2025
Niger : les cliniques mobiles pour un meilleur accès aux services de santé
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Niger
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Niger:
Histoire
21 mars 2025
Soumana devenu résilient grâce à la FAO
Agé de 47 ans, marié à 3 femmes et père de 10 enfants est devenu résilient grâce aux appuis de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ayant quitté l’université de Niamey en 2001 en 2ème année de droit, il est rentré au village où il s’est investi dans l’agriculture. A l’époque, la production agricole de Soumana ne dépassait guère les 40 bottes équivalent à 600 kg. « Je n’avais pas accès aux semences de qualité, comme tous les autres producteurs de mon village, pour booster ma production agricole. Je me contentais de celles disponibles sur les marchés locaux » a-t-il expliqué.C’est difficilement qu’il arrivait à subvenir aux besoins de sa famille. Dans sa recherche à combler le gap alimentaire chaque année, il était contraint d’abandonner son village pour se rendre dans des pays voisins. « Je ne suis pas parvenu à gagner véritablement les moyens à la hauteur de mes attentes. »Mais, depuis trois ans que la FAO a démarré ses appuis dont il est un des bénéficiaires en 2024, Soumana a pu obtenir les semences résilientes et de qualitépour produire durant la campagne pluviale.Avec l’appui de la FAO, la production céréalière de Soumana passe à 70 bottes soit 1 000 kg pour le mil et 750 kg pour le niébé dans son espace d’exploitation d’un hectare et demi. Cet appui de la FAO s’est fait dans le cadre de la mise en œuvre du programme « accélérer le progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales » financé par la Norvège et la Suède. Pendant la saison des cultures irriguées, il produit du niébé et se sert de ses fanes pour nourrir durant deux mois son troupeau d’animaux. En 2024, il s’est procuré, avec le soutien de la FAO, des semences de laitue, de la pomme de terre et de moringa en dehors de semences pluviales.Au cours de la période de soudure ou de précarité, il recourt aux produits maraichers comme les feuilles de moringa associées à la farine de mil, de sorgho ou de maïs pour assurer l’alimentation de sa famille. Ainsi, « je consacre entièrement ma force de travail à la production et récolte mieux ».La diversification de sa production a permis à Soumana, non seulement de varier l’alimentation de sa famille, mais aussi et surtout de générer beaucoup de profits. Dans son activité, il a pu s’acheter deux petits ruminants. « Dieu merci, aujourd’hui, je suis devenu résilient au point de n’avoir plus besoin d’un quelconque soutien pour prendre en charge ma famille ».Avec l’assistance de la FAO, Soumana affirme avoir accumulé des connaissances pratiques utiles en matière d’agriculture et d’élevage pour poursuivre et renforcer sa production. Il se voit dans les cinq prochaines années être un entrepreneur agricole capable de labourer des vastes étendues de terre à travers la mécanisation. Son ambition est de ramener les jeunes à la terre considérée comme étant « un véritable moyen d’atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnel des ménages dans les zones rurales».Ce genre d’ambition au Niger, la FAO le soutient à travers les semences irriguées et pluviales, le renforcement des capacités techniques sur les itinéraires techniques agricoles, le cash plus semences, la régénération naturelle assistée, les engrais, les aliments pour bétail, le système de la petite irrigation, les champs écoles agropastoraux, les clubs d’écoute Dimitra, les caisses de résilience, etc.Ce type d’appui de la FAO entre dans le cadre des multiples efforts de l’organisation à soutenir la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables afin d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté. Un tel appui contribue à l’atteinte des Objectifs de Développement Durables notamment les ODD 1, 2 et 12 qui portent respectivement sur « pas de pauvreté », « faim zéro » et « consommation et production responsable ».
1 / 5

Histoire
21 mars 2025
Des Héros de l’Ombre : L’Engagement des Volontaires des Nations Unies qui sauvent des Vies
Ils ne portent ni cape, ni insigne, et pourtant, ils sont des piliers de leur communauté. Ce sont les 18 Volontaires des Nations Unies (VNUs), engagés aux côtés de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Niger et de la Direction régional de la santé Publique de la Population et des Affaires sociales de Maradi pour apporter soins, écoute et espoir aux populations les plus vulnérables.Parmi eux, Moutari Sanda Chapiou, infirmier VNU, vit chaque jour au rythme des souffrances et des espoirs de ses patients. Dans la petite salle d’attente du centre de santé, une femme, visiblement affaiblie, serre la main de son enfant malade. Ses yeux trahissent la peur. Moutari s’approche, lui sourit et l’invite à entrer. Il pose un diagnostic, administre un soin, mais surtout, il prend le temps de parler. De rassurer. « Quand un malade me dit ‘Dieu te bénisse’, je ressens une immense fierté », confie-t-il. Il sait que ces mots valent plus qu’un salaire, plus qu’un diplôme. Ils sont la preuve qu’il fait une différence.À quelques kilomètres de là, Noufaissa Yahaya Moussa, sage-femme VNU, accueille une jeune femme enceinte pour une consultation prénatale. La future mère semble hésitante, peu habituée à fréquenter les centres de santé. Avec douceur, Noufaissa lui explique l’importance du suivi médical, l’encourage à revenir régulièrement. La jeune femme l’écoute, puis finit par avouer : « Je veux accoucher avec vous, car vous êtes gentille et accueillante. » Un lien de confiance s’est tissé, une barrière est tombée.Le travail des VNUs ne se limite pas aux centres de santé. Lors des inondations qui ont frappé la région, ils ont été parmi les premiers à répondre à l’urgence. Dans le camp des sinistrés, des centaines de familles ont tout perdu. En les voyant arriver, un vieil homme s’avance, les larmes aux yeux. Il serre la main de Moutari et murmure : « Vous êtes venus… on pensait qu’on nous avait oubliés. » À cet instant, il n’y a plus de chiffres, plus de statistiques, juste une vérité : leur présence change des vies. Mais l’engagement des VNUs ne s’arrête pas aux urgences. Jour après jour, ils éduquent, sensibilisent et accompagnent. Dans une école, Noufaissa parle d’hygiène à un groupe d’adolescents, expliquant avec patience pourquoi il est si important de se laver les mains. À la fin de la séance, un garçon s’approche et dit timidement : « Je vais l’expliquer à ma petite sœur. » Un simple geste, mais un impact durable.Malgré les défis – la pénurie de certains médicaments, les moyens limités – ils ne renoncent pas. Quand Noufaissa manque de fer pour ses patientes enceintes, elle leur apprend à adapter leur alimentation. Quand Moutari fait face à des patients angoissés, il leur offre du réconfort en plus des soins. Ils ne se contentent pas d’aider, ils trouvent des solutions.Les VNUs ne se considèrent pas comme des héros. Ils disent simplement qu’ils font leur part. Mais pour les mères qu’ils accompagnent, les enfants qu’ils soignent, les sinistrés qu’ils réconfortent, ils sont l’espoir dans les jours sombres, le sourire dans la douleur, la main tendue qui change tout.Dans un pays où les défis sanitaires existent, leur engagement est une promesse : celle qu’avec de la volonté, de l’écoute et du courage, chaque vie peut être transformée. Ecrit par Nana Hassoumi, Coordonnatrice du Programme des Volontaires nationaux au Niger
1 / 5

Histoire
20 mars 2025
Stimuler la production agricole pour multiplier les opportunités pour les communautés
Installée sur une pile de sacs de mil dans le village de Sarkin Hatsi, dans le sud du Niger, Sa'a Moussa esquisse un sourire de fierté. Aujourd'hui, c'est jour de livraison et, à l'entrepôt de sa coopérative composée exclusivement de femmes, elle attend avec impatience l'arrivée des camions qui viendront chercher leur récolte."Cela n'a pas toujours été le cas. Nous venons de loin", dit-elle en évoquant le parcours des 820 membres de l'association agricole Hadin Kan Mata (ODD5) qu'elle dirige, dans la région de Maradi.« Depuis longtemps, nous devons affronter des saisons qui changent de manière imprévisible. La pluie arrive, nous nous dépêchons de semer, puis la sécheresse frappe à nouveau, et nous perdons tout », souligne-t-elle, décrivant la lutte quotidienne de ces femmes contre les chocs climatiques.Dans la région de Maradi, comme dans de nombreuses zones au Niger, les agriculteurs font face à de nombreux défis, y compris la désertification accélérée et dégradation des sols. Le pays perd environ 100 000 hectares de terres chaque année. Ce qui représente un frein à l’atteinte de l’objectif de développement durable « Faim Zéro » (ODD 2). « Les pluies commencent plus tard et s’arrêtent souvent tôt, perturbant le cycle de production agricole de trois mois et réduisant les rendements », explique Ramatou Hinsa, Chargée du développement rural au Programme alimentaire mondial dans la région de Maradi.Les effets des chocs climatiques réduisent la production et menacent la sécurité alimentaire, ce qui pousse de nombreux hommes à chercher des opportunités ailleurs.« Beaucoup de nos hommes migrent vers le Nigeria ou l’Europe via la Libye, souvent sans revenir avant des années, voire jamais. Cela laisse les familles, surtout les femmes et les enfants, dans une grande vulnérabilité », affirme Sa’a Moussa.S’armer pour affronter les effets des chocs climatiquesDepuis 2012, le PAM collabore avec le gouvernement du Niger, les communautés et les organisations locales (ODD 17) pour aider les petits agriculteurs à accéder à des ressources et connaissances essentielles afin d’accroître leur production et leurs compétences entrepreneuriales. Outre les chocs climatiques, ces agriculteurs doivent faire face à l’accès limité aux intrants, aux marchés et au financement.« C’est une approche globale, de la récupération des terres à l’autonomisation des petits exploitants avec des compétences et des outils post-récolte, en passant par la recherche de débouchés pour leurs produits », précise Ramatou.Plus de 300 000 hectares de terres dégradées ont été récupérées par le PAM depuis 2014. À Maradi, le PAM travaille avec la Chambre régionale d’agriculture de Maradi pour proposer des solutions adaptées aux besoins des petits producteurs et entrepreneurs de la région."Nous soutenons les petits agriculteurs en formalisant leurs organisations, en leur fournissant des informations sur les marchés et le climat, et en renforçant leur visibilité par le biais de salons et de foires", explique Guéro Magala, secrétaire général permanent de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi.En conséquence, les agriculteurs ont vu leurs rendements s'accroître. "Grâce à la formation et aux semences améliorées, nos récoltes ont triplé. Auparavant, un hectare produisait 187,5 kg de mil ; aujourd'hui, il en produit de 750 kg à 1 000 kg", explique Moussa, présidente de la coopérative.Dynamiser l’économie locale et l’alimentation scolaireLes bonnes récoltes créent un excédent, permettant à la coopérative Hadin Ka Mata de trouver de nouvelles opportunités commerciales. « Nos produits ont bien marché grâce au soutien du PAM. Aussi, notre coopérative à Maradi a un contrat annuel avec le gouvernement », déclare Sa’a Moussa.« Grâce aux revenus de nos ventes, nos familles peuvent non seulement se nourrir à nouveau, mais surtout profiter de la vie et rêver à nouveau », annonce-t-elle avec joie.Cette initiative du PAM s’inscrit dans la stratégie nationale du Niger consistant à acheter à ses petits producteurs. Depuis 2013, le PAM a acheté plus de 27 000 tonnes de denrées alimentaires, d’une valeur de plus de 12 millions de dollars, principalement utilisées pour approvisionner les cantines scolaires (ODD 4).« Cette stratégie non seulement promeut les régimes alimentaires locaux, mais est aussi très économique. Elle comble le fossé entre les repas pris à la maison et à l'école, réduisant ainsi les coûts logistiques », explique Salou Abdou, Coordinateur régional des cantines scolaires de Maradi. Ces efforts renforcent la vie communautaire et les moyens de subsistance. « Nous sommes fiers de savoir que ce sont nos propres produits, et non des sources inconnues, qui nourrissent nos enfants à l’école. Ces aliments locaux nourrissent nos familles, et cela nous remplit de satisfaction », confie Elhaj Oumarou, chef du village de Sarkin Hatsi.Ce soutien s’aligne sur les efforts de résilience du PAM pour stimuler la production alimentaire locale dans ses programmes au Niger.Les initiatives du PAM en faveur des petits exploitants agricoles et d'autres communautés vulnérables du Niger sont rendues possibles grâce aux pays suivants: Allemagne, Danemark, États-Unis, France, Norvège et l’Union Européenne
1 / 5

Histoire
18 mars 2025
Garantir un bon départ à travers des Soins maternels et néonatals de qualité
I ll est midi ce mercredi 22 mai 2024, c’est l’heure de visite aux malades au Centre de Santé de la Mère et de l’Enfant (CSME) de Maradi, une région située au centre-sud du Niger, frontalière avec le Nigeria. Ce centre de référence, le seul de la région en matière des soins pour la mère et l’enfant, accueille mères, femmes enceintes, enfants et nouveau-nés. Beaucoup viennent directement, mais la plupart sont référés par les centres de santé périphériques des villages et des districts sanitaires de la région. À l’unité des soins de néonatologie, l’une des plus importantes du centre, les équipes sont à pied d’œuvre. Pendant que certains prennent des constantes et placent des cathéters aux nouveaux admis aux soins, Ali Dayabou, technicien supérieur en soins infirmiers, vérifie les températures des bébés avant de placer un concentrateur d’oxygène à un nouveau-né admis pour détresse respiratoire. Le travail des infirmiers est crucial dans ce centre : ils sont chargés d’administrer les premiers soins aux bébés, de faire le suivi et de veiller à l’amélioration de l’état de santé de ces nouveau-nés dont certains sont nés il y a tout juste quelques heures. « Nous accueillons des bébés nés au centre et des bébés nés avec des complications, référés par d’autres structures de santé comme les maternités et les centres de santé intégrés de la région. Les difficultés concernent surtout les bébés référés. Les cas les plus fréquents que nous recevons sont les bébés prématurés, les bébés ayant un ballonnement abdominal, les enfants gavés avec des décoctions, des cas de malformation, des cas d’infections bactériennes sévères mais aussi des enfants qui refusent de téter. À leur arrivée ici, les mamans ont souffert, les bébés ont souffert, ils arrivent pour la plupart dans un état critique. Notre priorité est d’abord de stabiliser le bébé et, au besoin, de faire appel aux services spécialisés car ici nous avons les spécialistes selon les complications. » confie Dayabou. Dans un centre pareil, la disponibilité des équipements, de médicaments et de personnel formé est la clé de réussite de cette mission cruciale pour sauver des vies. C’est pourquoi, depuis son ouverture en 2011, l’Etat et ses partenaires dont UNICEF sont aux côtés du CSME de Maradi à l’instar des autres centres des autres régions pour apporter l’appui nécessaire en termes de matériel, équipements, intrants et formation au personnel. UNICEF a particulièrement dans le cadre du financement de Monaco déployé d’importants équipements et médicaments pour les soins aux nouveaux né d’une part et d’autres part a appuyé le renforcement des capacités des prestataires dans les centres de santé (CSME, Hôpitaux des Districts et CSI) sur des thématiques portant sur les soins aux nouveaux nés y compris la prise en charge des infections bactériennes sévères là où la référence n’est pas possible (PSBI). Dans le même ordre des relais communautaires ont été formés et ont reçu des connaissances pour détecter et référer aux centres de santé des nouveaux nés présentant des signes de danger. « Auparavant, on avait pas de méthodologie quand il s’agissait de soins essentiels, on faisait tout pêle-mêle. Grâce à la formation, nous avons compris l’importance des soins essentiels dès la naissance, mais aussi qu’il y a des étapes à suivre, comme obtenir les premiers pleurs du bébé, bien faire les soins au cordon... Prendre deux minutes pour prodiguer ces soins peut protéger l’enfant durant des années. » témoigne l’infirmier. Les soins de santé primaires prodigués au nouveau-né immédiatement après sa naissance assurent un bon départ et permettent d’éviter des complications potentielles. Malheureusement, beaucoup de nouveau-nés référés ne bénéficient pas correctement de ces soins. C’est pourquoi, L’UNICEF grâce au financement de la Principauté de Monaco, a soutenu un stage clinique pour les sages-femmes des maternités des districts sanitaires de Maradi afin qu’elles puissent participer à une immersion pratique au CSME sur les soins essentiels aux nouveau-nés. « Beaucoup d’entre elles avaient du mal à trouver les voies veineuses des bébés ou à réaliser d’autres gestes essentiels. Durant le temps passé avec nous, nous avons effectué des réanimations avec elles, nous leur avons appris la méthode de peau à peau, les soins des yeux… » confie Dr Lamine, pédiatre et responsable de l’Unité de Néonatologie.En 2023, cette unité a enregistré plus de 5000 patients, et les coupures d’électricité récentes auraient pu causer des dégâts sans l’installation d’un groupe électrogène et de carburant fourni par l’UNICEF. « C’était vraiment un ouf de soulagement, ce groupe qui nous a permis d’éviter le pire », conclut Dr Lamine.Au-delà du sacrifice quotidien fourni par le personnel pour sauver des enfants entre la vie et la mort, c’est une fierté pour les agents comme Dayabou d’être au chevet de ces bébés et de contribuer à redonner le sourire à leurs mamans : « Voir une mère désespérée repartir avec son bébé dans les bras, toute souriante, nous procure une grande satisfaction morale. »Le Centre de Santé de la Mère et de l’Enfant de Maradi joue un rôle crucial dans la région, offrant des soins de qualité qui sont indispensables aux mères et aux nouveau-nés. Le soutien constant des partenaires est vital pour maintenir et améliorer la qualité des soins prodigués.
1 / 5

Histoire
18 mars 2025
Le parcours résilient des femmes déplacées de Tingara
Depuis l’attaque tragique qui a contraint des centaines de familles à fuir le village de Tingara 2 en février 2019, de nombreuses femmes déplacées ont trouvé refuge dans le site de Tadress, en périphérie de Tillabéri. Face à l’adversité, elles ont su faire preuve d’une résilience remarquable, soutenues par l’ONG JAAD. Leur histoire illustre la force du collectif et l’impact positif qu’une organisation dédiée peut apporter à des communautés en détresse.En février 2019, une attaque d’éléments présumés de Groupes Armés Non-Étatiques (GANE) a frappé le village de Tingara, dans la commune de l’Anzourou. Environ 216 ménages, soit 1 500 personnes dont Mamou Hassimi, 46 ans, mère de cinq enfants et Haoua Issaka, 31 ans et mère de sept enfants, ont fui leurs foyers, abandonnant maisons, terres et moyens de subsistance. Elles ont marché durant quinze jours pour atteindre Tillabéri, bravant la faim, la fatigue et la maladie. « Ce départ forcé reste le pire moment de ma vie ; nombreux sont ceux qui étaient tombés malades ; d’autres n’y ont pas survécu tandis que certains donnèrent la vie au cours de cet odyssée. » – Mamou Hassimi. À Tillabéri, dès leur arrivée, elles furent accueillies par les autorités locales avec une première assistance en vêtements et en nourriture. Par la suite, le Programme alimentaire mondial (PAM), des ONG nationales et internationales leur ont distribué des céréales, de l’huile, du sel et du sucre pour une durée de trois mois. La rencontre avec JAAD : vers l’autonomisationLa vie de ces rescapées de Tingara va changer à partir de 2020, à la suite de leur rencontre avec l’ONG nationale Jeunesse Africaine et Actions de Développement (JAAD), dans le cadre du réseau « West African Network for peacebuilding » (Wanep). Ce fut le début d’une collaboration fructueuse qui aura permis de se constituer en groupement de 33 membres, dénommé « Lakal Kaney ». Ensuite, JAAD a renforcé leurs capacités en vie associative, en sensibilisation sur la cohésion sociale mais aussi en techniques de transformation de produits alimentaires. L’initiative n’a pas tardé à faire des émules, car aussitôt, les femmes de la communauté hôte se sont de leur côté organisées en groupement dénommé « Fahamey » avec 45 membres ; engageant un échange solidaire avec leurs consœurs déplacées. Commence alors une relation forte fondée sur la cohésion sociale entre ces femmes que la providence à mises ensemble ; en témoigne le partage d’expériences et de savoir-faire. « Grâce aux formations en transformation de produits alimentaires et la fabrication de savon, nous pouvons désormais subvenir à nos besoins, assurer la scolarisation de nos enfants et reprendre confiance en nous », a déclaré pour sa part Haoua Issaka. Elles apprirent les unes des autres comment produire du savon liquide et solide, comment transformer du maïs en produits dérivés, comment valoriser de l’arachide en tourteaux et en pâte, et comment transformer des ressources locales comme le sésame, le soumbala et les feuilles de corètes. L’expérience a montré que les réponses aux crises et catastrophes peuvent être encore plus efficaces qu’elles ne le sont, si les programmes d’interventions faisaient davantage attention aux besoins spécifiques de chaque catégorie de personnes affectées par les crises, comme on peut le voir avec JAAD et les femmes de Tadress.Une success story confirmée : la foire de NiameyDébut 2025, JAAD est revenue à Tillabéri pour inviter plusieurs femmes de Tadress à la foire agropastorale et halieutique « Sahel Niger 2025 » à Niamey. Elle les dota de kits d’autonomisation pour renforcer leurs capacités pour ce faire. Et puis à la suite d’un processus de sélection organisé par cette ONG, Mamou, Haoua et deux autres femmes de la communauté hôte de Tadress ont été retenues pour participer à cet événement. « Nous sommes désormais visibles en tant que groupement de la région de Tillabéri dans ce que nous savons faire de mieux en matière de transformation de produits alimentaires ; mais il faut le dire, nous avons aussi beaucoup appris des autres, découvert les produits d’autres groupements et entrepreneures venus de tout le pays et de la sous-région, tissé des liens et développé un réseau de partage d’expériences », a déclaré Marie Doulla, du groupement « Fahamey », membre de la communauté hôte. Cette première participation à un événement d’envergure internationale avait tout l’air d’une consécration pour ces femmes venues de loin. Les femmes sont revenues encore plus motivées, conscientes de l’importance d’améliorer la qualité de leurs produits pour conquérir de nouveaux marchés.Un modèle de résilience et de solidaritéPour Mamou, Haoua et ses compagnes, ce parcours témoigne avant tout de leur détermination face aux crises successives qui touchent la région de Tillabéri. Au-delà de la survie, ces femmes déplacées ont trouvé les ressources pour reconstruire leur vie et s’intégrer dans une nouvelle communauté grâce à la synergie entre JAAD, les autorités locales et d’autres partenaires.« Le 8 mars est une occasion de célébrer les progrès accomplis par les femmes, mais aussi de mettre en lumière l'importance de leur autonomisation dans tous les aspects de la vie. L'aide humanitaire doit impérativement prendre en compte cette réalité en accordant une priorité aux organisations locales dirigées par des femmes, qui sont au cœur des solutions adaptées aux besoins des communautés. En leur fournissant davantage de ressources et de pouvoir d'action, nous contribuons non seulement à renforcer la résilience des populations, mais aussi à faire émerger des leaders féminines, actrices essentielles dans la construction de sociétés plus justes, inclusives et durables », a dit ABDOU IDI Haoua, Coordonnatrice Nationale de l'ONG JAAD, une organisation qui travaille à promouvoir le leadership des femmes au Niger. Cette histoire est un appel à multiplier les actions de soutien aux populations déplacées et à promouvoir l’autonomisation des femmes, levier essentiel pour renforcer la résilience communautaire. Malgré les difficultés, l’expérience de Tingara et de Tadress montre qu’avec un accompagnement adapté, il est possible de retrouver une vie digne et de contribuer activement au développement économique local.Vers l’avenirLe parcours de Mamou, Haoua et des femmes de Tingara met en lumière la force de la solidarité et le rôle essentiel de l’accompagnement dans un contexte de crise. Leur participation à la foire de Niamey confirme qu’en dépit des obstacles, l’audace, la persévérance et le soutien ciblé peuvent ouvrir de nouvelles perspectives à celles et ceux qui ont tout perdu. Plus largement, il s’agit d’une leçon universelle : l’espoir et l’entraide peuvent devenir de puissants moteurs de reconstruction et d’autonomisation.
1 / 5

Histoire
14 juillet 2025
Sani, volontaire au service de la restauration des écosystèmes pour le bien-être des communautés
Casquette vissée sur la tête et regard attentif derrière ses lunettes noires, il parcourt un vaste site de terres improductifs depuis plus de 30 ans, aujourd’hui tapissé d’herbes et d’arbustes qui brille d'un vert remarquable. « Nous sommes sur un site où la terre a été récupérée », dit-il fièrement, en désignant les jeunes arbres qui s’étendent désormais à perte de vue sur 171 hectares.Il y a encore quelques années, cette zone n’était qu’une étendue aride, marquée par la dégradation des sols et l’avancée du désert. Aujourd’hui, grâce aux efforts conjoints des communautés locales, du PAM et de volontaires comme Sani, la terre renaît. Situé dans la commune de Chadakori, Kouroungoussaou est l’un des nombreux sites de la région de Maradi où le PAM œuvre pour restaurer les terres dégradées tout en renforçant la résilience des communautés face aux chocs climatiques. « Grâce au soutien du PAM et de ses partenaires, on voit maintenant des arbres à perte de vue, des pâturages pour les animaux, et une nature qui renaît », explique Sani, observant au loin un troupeau qui profite paisiblement de la végétation revenue. En 2024, plus de 38 000 hectares de terres ont été récupérés dans tout le pays, portant à plus de 317 000 hectares le total restauré depuis 2014. Ce progrès impressionnant est le fruit d’une forte mobilisation communautaire, appuyée par des acteurs engagés comme les six Volontaires des Nations Unies actuellement déployés aux côtés du PAM. Une planification Communautaire au cœur du changement Pour Sani, chaque avancée commence sur le terrain, avec les communautés elles-mêmes. « En tant qu’associé au programme de résilience, je participe à la planification communautaire participative, à l’organisation des formations, aux séances d’ingénierie sociale pour l’implémentation des activités et aux suivies des activités », explique-t-il. Son rôle ne se limite pas à un accompagnement technique : il veille à ce que les actions mises en œuvre soient durables et réellement adaptées aux besoins locaux. Le travail de proximité avec les populations rurales lui a permis de comprendre que l’appropriation communautaire est la clé de la durabilité des interventions. « Le volontariat est pour moi une manière concrète de contribuer au développement de mon pays. Être un soldat de la résilience, c’est être utile aux autres », souligne-t-il.
1 / 5

Histoire
10 juillet 2025
Consolider la paix face aux changements climatiques : le PBF et ses partenaires à l’écoute des communautés de Tahoua
Du 2 au 9 juillet 2025, une mission conjointe du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF) et de ses partenaires – la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), ONU Femmes, UNFPA et UNCDF – s’est rendue dans plusieurs localités de la région de Tahoua, notamment Tchintabaraden, Allela, Bagaroua et Konni, dans le cadre du projet « Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques » ('PBF/NER/C-3: Consolidation de | MPTF Office).Cette initiative vise à répondre à l’un des défis les plus pressants du Niger : l’impact croissant des changements climatiques sur la cohésion sociale, la sécurité alimentaire et la stabilité communautaire. Dans une région où les ressources naturelles sont de plus en plus rares, la compétition pour leur accès peut devenir source de tensions entre communautés pastorales, agricoles et nomades. Des mécanismes communautaires efficaces de gestion des conflitsLors de cette mission, les équipes ont rencontré les autorités locales, les mécanismes communautaires de gestion des conflits, les médiateurs communautaires ainsi que de nombreux bénéficiaires du projet. Il ressort de ces échanges une dynamique positive : les comités de prévention et de gestion des conflits sont aujourd’hui bien établis et jouent un rôle déterminant dans l’apaisement des tensions locales. À ce jour, plus de 1 988 conflits ont été prévenus et 1 765 gérés grâce à l’engagement actif des 1 898 membres de ces mécanismes, dont 1 041 femmes et 49 personnes vivant avec un handicap. Les dialogues intercommunautaires réguliers et la mobilisation des leaders locaux ont permis d’anticiper et de résoudre de manière pacifique de nombreux différends liés à l’usage des ressources naturelles.Un soutien renforcé aux structures publiques et de sécuritéDans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), le projet appuie les structures de l’État avec la réhabilitation et l’équipement de sept salles d’écoute réparties dans quatre postes de police et trois brigades de gendarmerie des communes d’intervention. Ces dispositifs offrent un accueil sécurisé et confidentiel aux survivant(e)s de violences, tout en renforçant les capacités institutionnelles locales.Autonomisation économique des femmes et des jeunesLe projet s’attache également à renforcer la résilience économique des communautés vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Des activités génératrices de revenus (AGR) sont en cours dans plusieurs communes. À Tchintabaraden et Allela, des cultures maraîchères (pommes de terre, oignons, laitues, piments verts) sur des surfaces d’au moins 2 ha permettent aux groupements de femmes de diversifier leurs revenus. À Tassara, un forage moderne alimente une surface de 25 ha, avec quatre bassins de stockage d’eau facilitant les cultures irriguées. Des initiatives de transformation d’arachide (huile, tourteaux) ainsi que des activités d’élevage via des kits caprins sont également mises en œuvre, générant des revenus tout en favorisant l’inclusion économique. Restauration écologique et mobilisation communautaireSur le plan environnemental, le projet mise sur des activités de Haute Intensité de Main-d'œuvre (HIMO) pour restaurer les terres dégradées. La réalisation de bandes pare-feu et de demi-lunes (315 par ha) permettra, à terme, de récupérer plus de 710 hectares de terres dans les sept communes d’intervention. Ces travaux, portés par les communautés elles-mêmes, renforcent la résilience face aux aléas climatiques tout en créant des emplois temporaires locaux (jusqu’à 120 000 FCFA par participant dans le cadre des travaux HIMO).Ce projet du PBF incarne l’approche intégrée des Nations Unies, en combinant résilience climatique, prévention des conflits et développement inclusif. Il démontre qu’une approche territorialisée, centrée sur les besoins des populations locales et portée par une coordination étroite entre les acteurs nationaux et internationaux, peut contribuer à bâtir durablement la paix.
1 / 5

Histoire
27 juin 2025
Niger : les cliniques mobiles pour un meilleur accès aux services de santé
En effet, seule une personne sur deux a accès aux services de santé, ce qui représente un défi de taille que le gouvernement s'efforce de relever. Parmi les stratégies adoptées pour rapprocher les services de santé des populations, figure la mise en place de cliniques mobiles dans les localités reculées, grâce au déploiement d’équipes médicales des districts sanitaires dans les villages.
Les femmes enceintes bénéficient particulièrement de cette initiative qui leur permet d’être suivies en urgence en cas de complications. À 42 ans, Mariama en était à sa huitième grossesse lorsqu’elle a fait un faux pas qui lui a causé des complications. De son domicile à Batako, dans le district sanitaire de Dosso, jusqu’à l’hôpital le plus proche, il lui aurait fallu marcher 35 kilomètres, soit une journée entière. « Alors que je me préparais à effectuer le voyage, j’ai été informée de l’arrivée d’une clinique mobile dans notre localité et je m’y suis rendue dès le lendemain. La sage-femme de l’équipe m’a consultée et a découvert que j’avais une rupture prématurée des membranes », explique-t-elle. « Les équipes de clinique mobile se rendent dans les villages ayant un accès difficile aux soins de santé en général et en particulier aux services de la santé de la reproduction qui concerne les femmes et les enfants. C’est un immense soulagement qui fait que les femmes enceintes arrivent notamment à bénéficier de soins permettant d’identifier les risques à temps, et de leur fournir une prise en charge adaptée », explique Nafissatou Salifou Panga, sage-femme et Point focal de santé de la reproduction du district sanitaire de Dosso.
Grâce aux soins reçus et au suivi médical, Mariama a donné naissance à une fille en bonne santé trois semaines plus tard. Tout comme Mariama, 267 femmes enceintes des districts de Dosso et Filingué, au sud-ouest du pays, ont bénéficié des consultations des cliniques mobiles en 2024. Au total, près de 28 000 personnes ont été consultées et 3767 femmes ont eu accès aux services de santé reproductive. Environ 16 000 femmes ont été sensibilisées par les relais communautaires sur la santé reproductive, maternelle et néonatale dans les deux districts. Dans le cas de Mariama, les relais communautaires ont partagé les messages de sensibilisation qui lui ont permis d’être informée à temps de l’arrivée de la clinique mobile.En desservant les populations éloignées des centres de santé, la stratégie des cliniques mobiles contribue à améliorer par ailleurs la couverture sanitaire en rehaussant les indicateurs aux niveaux district et national. Par exemple, le taux de mortalité maternelle est passé de de 441 pour 100 000 naissances vivantes en 2017 à 350 en 2023, selon les données de la Banque mondiale.
Des avancées dont se réjouit la Dre Aissatou Laouali, chargée du programme de santé reproductive à l’OMS Niger : « Pour les groupes vulnérables de la population, l’accès rapide à des soins de santé de qualité est primordiale. Nous espérons à travers ces initiatives aller de l’avant pour résoudre les défis que vivent particulièrement les mères et enfants vivant dans les zones reculées. »Pour assurer la qualité du service, le district, en collaboration avec l’OMS, organise des réunions de planification et des sorties de supervision sur le terrain. L’OMS appuie globalement le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publiques dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile à travers notamment par la mise à disposition d’orientations techniques, de normes et protocoles en matière de santé reproductive, santé maternelle et infantile. Il est à noter également le renforcement des capacités du personnel de santé, du plateau technique des centres de santé Mère-Enfant, des hôpitaux régionaux et de district ainsi que des centres de santé intégrés. L'OMS appuie également la formation des prestataires en qualité des soins et la surveillance des décès maternels. Le Niger parvient à pérenniser les cliniques mobiles introduites il y a plusieurs décennies. En 2024, avec l’appui de l’OMS avec le soutien financier d’un donateur a permis de prendre en charge toutes les dépenses liées aux activités des cliniques mobiles incluant la fourniture des kits et autres produits médicaux ainsi que les frais de déplacements des équipes dans les districts sanitaires de Dosso et de Filingué. Durant l’année, 56 professionnels de santé et relais communautaires ont été formés dans les deux districts sur la santé reproductive grâce à l’appui financier du donateur.
L’offre de services de santé reproductive comprend notamment sur les soins prénatals et postnatals, les consultations des nourrissons, la planification familiale, le dépistage de la malnutrition et la vaccination.« J’ai été très satisfaite des soins et j’ai reçu des injections et des médicaments, ainsi qu’un carnet de suivi. J’encourage les femmes de ma communauté à se rendre à la clinique mobile pour tout problème de santé. Si je n’étais pas allée au centre après l’incident, j’aurais eu une infection avec le risque de perdre mon bébé ! »
Les femmes enceintes bénéficient particulièrement de cette initiative qui leur permet d’être suivies en urgence en cas de complications. À 42 ans, Mariama en était à sa huitième grossesse lorsqu’elle a fait un faux pas qui lui a causé des complications. De son domicile à Batako, dans le district sanitaire de Dosso, jusqu’à l’hôpital le plus proche, il lui aurait fallu marcher 35 kilomètres, soit une journée entière. « Alors que je me préparais à effectuer le voyage, j’ai été informée de l’arrivée d’une clinique mobile dans notre localité et je m’y suis rendue dès le lendemain. La sage-femme de l’équipe m’a consultée et a découvert que j’avais une rupture prématurée des membranes », explique-t-elle. « Les équipes de clinique mobile se rendent dans les villages ayant un accès difficile aux soins de santé en général et en particulier aux services de la santé de la reproduction qui concerne les femmes et les enfants. C’est un immense soulagement qui fait que les femmes enceintes arrivent notamment à bénéficier de soins permettant d’identifier les risques à temps, et de leur fournir une prise en charge adaptée », explique Nafissatou Salifou Panga, sage-femme et Point focal de santé de la reproduction du district sanitaire de Dosso.
Grâce aux soins reçus et au suivi médical, Mariama a donné naissance à une fille en bonne santé trois semaines plus tard. Tout comme Mariama, 267 femmes enceintes des districts de Dosso et Filingué, au sud-ouest du pays, ont bénéficié des consultations des cliniques mobiles en 2024. Au total, près de 28 000 personnes ont été consultées et 3767 femmes ont eu accès aux services de santé reproductive. Environ 16 000 femmes ont été sensibilisées par les relais communautaires sur la santé reproductive, maternelle et néonatale dans les deux districts. Dans le cas de Mariama, les relais communautaires ont partagé les messages de sensibilisation qui lui ont permis d’être informée à temps de l’arrivée de la clinique mobile.En desservant les populations éloignées des centres de santé, la stratégie des cliniques mobiles contribue à améliorer par ailleurs la couverture sanitaire en rehaussant les indicateurs aux niveaux district et national. Par exemple, le taux de mortalité maternelle est passé de de 441 pour 100 000 naissances vivantes en 2017 à 350 en 2023, selon les données de la Banque mondiale.
Des avancées dont se réjouit la Dre Aissatou Laouali, chargée du programme de santé reproductive à l’OMS Niger : « Pour les groupes vulnérables de la population, l’accès rapide à des soins de santé de qualité est primordiale. Nous espérons à travers ces initiatives aller de l’avant pour résoudre les défis que vivent particulièrement les mères et enfants vivant dans les zones reculées. »Pour assurer la qualité du service, le district, en collaboration avec l’OMS, organise des réunions de planification et des sorties de supervision sur le terrain. L’OMS appuie globalement le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publiques dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile à travers notamment par la mise à disposition d’orientations techniques, de normes et protocoles en matière de santé reproductive, santé maternelle et infantile. Il est à noter également le renforcement des capacités du personnel de santé, du plateau technique des centres de santé Mère-Enfant, des hôpitaux régionaux et de district ainsi que des centres de santé intégrés. L'OMS appuie également la formation des prestataires en qualité des soins et la surveillance des décès maternels. Le Niger parvient à pérenniser les cliniques mobiles introduites il y a plusieurs décennies. En 2024, avec l’appui de l’OMS avec le soutien financier d’un donateur a permis de prendre en charge toutes les dépenses liées aux activités des cliniques mobiles incluant la fourniture des kits et autres produits médicaux ainsi que les frais de déplacements des équipes dans les districts sanitaires de Dosso et de Filingué. Durant l’année, 56 professionnels de santé et relais communautaires ont été formés dans les deux districts sur la santé reproductive grâce à l’appui financier du donateur.
L’offre de services de santé reproductive comprend notamment sur les soins prénatals et postnatals, les consultations des nourrissons, la planification familiale, le dépistage de la malnutrition et la vaccination.« J’ai été très satisfaite des soins et j’ai reçu des injections et des médicaments, ainsi qu’un carnet de suivi. J’encourage les femmes de ma communauté à se rendre à la clinique mobile pour tout problème de santé. Si je n’étais pas allée au centre après l’incident, j’aurais eu une infection avec le risque de perdre mon bébé ! »
1 / 5

Histoire
07 avril 2025
SONNE : Un nouveau souffle pour la santé maternelle et néonatale au Niger
Niamey – Lorsque Aichatou, âgée de 19 ans et originaire de Birni dans la région de Dosso, a découvert qu'elle était enceinte de son premier enfant en 2023, son souhait était de vivre une grossesse et un accouchement sans complications. Mais elle hésitait à se rendre au centre de santé. « Mes sœurs me disaient que le personnel n’accordait pas suffisamment d’attention aux femmes lors des consultations prénatales, et que les soins étaient lents », raconte-t-elle. Alors que le taux de mortalité maternelle reste encore élevé, estimé à 441 pour 100 000 naissances vivantes en 2020. Le taux de mortalité néonatale a quant à lui augmenté, passant de 24 à 43 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2012 en 2021. En 2021, seulement 43 % des naissances ont été assistées par un personnel de santé qualifié, ce qui révèle l’urgence d’améliorer l’accès aux soins.Selon le rapport 2023 sur la Surveillance des décès maternels périnatals et riposte (SDMPR), les principales causes directes de décès maternels au Niger sont notamment les hémorragies (34 %), les troubles de l’hypertention (28 %), les infections (24 %) et les accouchements difficiles (3 %). Bien que ces causes soient largement évitables, beaucoup de femmes accouchent encore à domicile, loin des structures de santé. Cette situation est accentuée par une faible couverture sanitaire de 55,45 % en 2023, indique le rapport 2023 du Système national de l'information sanitaire (SNIS). Face à cette situation, le Ministère de la santé publique, de la population et des affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’appui du Fonds Muskoka, a lancé en 2023 le projet de promotion de soins intégrés obstétricaux et néonatals essentiels (SONNE). Il vise à améliorer la santé maternelle et néonatale et est exécuté par l'ONG Action pour le bien-être (APBE) dans les régions de Dosso et de Zinder. Le projet SONNE est mis en œuvre dans quatre formations sanitaires par région notamment dans deux centres de santé intégrés, un hôpital de district et un centre de santé mère-enfant. Pour renforcer l'accès aux services, 22 professionnels en santé maternelle et néonatale et 100 relais communautaires ont été formés. Les relais communautaires, dont la mission est de sensibiliser les communautés sur la santé de la reproduction surtout les femmes en âge de procréer, jouent un rôle clé en incitant les femmes enceintes à se rendre en consultation prénatale. Ils font du porte-à-porte pour rendre visite aux femmes enceintes et les invitent à accoucher dans des centres de santé avec l’assistance d’un personnel qualifié. « Avant le programme SONNE, beaucoup de femmes accouchaient à la maison, sans aide médicale. Aujourd'hui, je les encourage à consulter régulièrement dès le début de la grossesse et à accoucher au centre de santé. Grâce à la sensibilisation, les femmes prennent plus de responsabilités envers leur santé et celle de leurs enfants », explique Hadiza, qui fait partie des relais communautaires formés à Dosso. Grâce aux efforts de sensibilisation menés dans les communautés, le nombre d’utilisatrices des services a augmenté de 40 % entre 2022 et 2023 dans les formations sanitaires de la zone d’intervention de la région de Dosso.« Depuis la formation, nous avons amélioré la qualité des soins que nous offrons. Non seulement les mères viennent plus régulièrement consulter, mais elles sont aussi mieux informées sur l'importance de l'accouchement en milieu sécurisé. C'est un changement de mentalité qui porte ses fruits et nous voyons de plus en plus de bébés naître en bonne santé », affirme Boubacar Halima, responsable du Centre de santé intégré de Birni. L’OMS et ses partenaires accompagnent le renforcement des services en faveur de la santé maternelle et néonatale. Grâce au projet SONNE, les centres de santé enrôlés ont été équipé en outils essentiels pour la prise en charge des nouveau-nés, tels que des tables chauffantes et des bandeaux kangourous, essentiels pour prévenir l’hypothermie chez les bébés prématurés ou de faible poids. L’Organisation a soutenu la mise en place d’un système de surveillance des décès maternels et néonatals, qui permet de signaler rapidement les décès, de comprendre leurs causes et de prendre des mesures correctives pour rendre les soins meilleurs. « L’audit des décès maternels contribue à la réduction de la mortalité maternelle à travers des services qui sont constamment améliorés », explique la Dre Laouali Aissatou, responsable du programme santé maternelle et néonatale à l’OMS Niger. « Grâce à ce cadre de surveillance, l’OMS soutient le pays dans le renforcement de l’analyse des tendances de mortalité et l’ajustement des politiques de santé afin de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. »Le programme SONNE constitue une avancée majeure vers de meilleurs de soins de santé pour les mères et les nouveau-nés au Niger. Ce programme est un soutien essentiel qui, à long terme, peut véritablement changer la donne et offrir une chance de vie à des milliers de mères et de nouveau-nés. Grâce à des soins de qualité, une sensibilisation renforcée et un suivi constant, des vies sont sauvées.Aujourd'hui, la situation a changé. Aichatou, qui a été accompagnée par Hadiza, a pu bénéficier de consultations prénatales, d’un suivi attentif, et d’un accouchement sécurisé. « Tout le monde était à l'écoute. Je suis allée aux consultations prénatales et c’est tout le contraire de ce qu’on m’avait dit. Les sage-femmes sont si gentilles et mon accouchement s’est bien passé », confie-t-elle. « Je conseille à toutes les femmes enceintes de ne plus accoucher à la maison. Avec une bonne assistance, on quitte le centre de santé en pleine forme avec un bébé en bonne santé, c'est ce qui compte vraiment. »
1 / 5

Histoire
27 mars 2025
De la mendicité à l’autonomie : l’émancipation des femmes handicapées de Maradi
À Maradi, au Niger, la vie des femmes en situation de handicap fut longtemps et très souvent marquée par l’exclusion et la mendicité. Reléguées aux marges de la société, elles arpentent les carrefours, un récipient à la main espérant quelques pièces pour survivre. Mais en 2024, une lueur d’espoir a émergé. Badaria, 38 ans, jeune femme sourde, se souvient : « Je mendiais depuis des années, honteuse mais résignée. Un jour, j’ai croisé le regard d’une formatrice du FONAF. Elle m’a dit : “Tu as en toi le pouvoir de changer ta vie.” Ces mots ont tout bouleversé. »Octobre 2024 : le PNUD Niger forme 622 femmes rurales, dont 32 handicapées, aux techniques de teinture et transformation alimentaire. Grâce au programme d’autonomisation inclusive en partenariat avec le FONAF (Forum National pour l’Autonomisation des Femmes), ces femmes ont reçu des formations en teinture locale, transformation de céréales et micro-entrepreneuriat. En plus de ces compétences, elles ont obtenu des subventions pour lancer leurs activités. Badaria, jeune femme sourde et mendiante en interview après sa formation au FONAFBadaria témoigne : « Aujourd’hui, je fabrique des tissus teintés avec mes propres motifs si uniques, et je produis de la farine infantile enrichie avec des céréales de Maradi. Grâce à la formation et à la subvention de 150 000F que j’ai reçue, je fructifie mes revenus et nourris ma famille ». Elle forme à son tour d'autres femmes handicapées, leur déclarant avec conviction : " Je n'imaginais pas être utile à la société et gagner mon propre argent. Une personne handicapée est seulement celle qui ne veut rien faire avec sa tête, ses pieds et ses dix doigts."Baraka, une autre bénéficiaire handicapée, raconte : « J’ai appris à transformer diverses céréales en couscous, à teindre des tissus avec mes créations, et à gérer une microentreprise. Je me sens renaître en 2024 ! Baraka, heureuse de donner un autre sens à sa vieElle ajoute, « Avant, je traînais ma bosse aux carrefours, désespérée. A présent, je retourne encore aux carrefours où je mendiais autrefois, non plus pour demander l’aumône mais pour y écouler mes produits. Chaque vente est une victoire, une preuve que je peux être utile. »Autrefois invisibles, ces femmes en situation d’handicap, se sont constituées en groupes d’entraide à Maradi et forment à leur tour, leurs paires dans les villages d’Aguié et Badaguichiri. Unies au sein des groupements, elles transforment leur vulnérabilité en force collective, démontrant qu'avec les compétences appropriées, tout destin peut se réinventer.Elles vendent désormais leurs produits sur les marchés et lors de cérémonies de mariage à Maradi. Leur prochaine étape ? Formaliser leurs activités et mettre fin à la mendicité pour de bon.L’histoire de ces femmes handicapées et mendiantes témoigne avec force que l’espoir et la dignité peuvent renaître, même auprès des populations les plus vulnérables, lorsque l’aide au développement s’aligne sur leurs besoins intrinsèques. Grâce à l’appui du PNUD Niger à l’autonomisation des femmes de Maradi, 622 femmes de Maradi ont non seulement changé leur vie, mais deviennent des modèles pour d’autres communautés marginalisées, insufflant un espoir nouveau !
1 / 5

Communiqué de presse
27 juin 2025
Le Niger se mobilise pour la 4ᵉ Conférence Internationale sur le Financement du Développement (FFD4) : vers des engagements concrets pour accélérer la mise en œuvre des ODD
Dans un environnement mondial marqué par la réduction des ressources concessionnelles, les réformes urgentes de l’architecture financière internationale et les défis sécuritaires croissants, le Niger souhaite renforcer son plaidoyer pour un financement plus équitable, prévisible et aligné sur ses priorités nationales. La réunion s’inscrit dans la dynamique du UN80, du Pacte pour le Futur et du Nouveau Cadre de Financement (Funding Compact), visant à doter les Nations Unies et leurs partenaires d’outils modernes pour soutenir les Objectifs de Développement Durable (ODD). Un engagement collectif pour des solutions durablesMme Ngoné Diop, Directrice du Bureau de la CEA en Afrique de l’Ouest, a mis en lumière les opportunités qu’offre l’initiative UN80, notamment en matière de gains d’efficacité, de gouvernance financière et de transparence. Le Pacte pour le Futur, quant à lui, appelle à une refondation des pratiques de financement pour les générations futures, avec un accent particulier sur la jeunesse, l’innovation, la paix et le développement durable. Des perspectives économiques contrastéesLors de son intervention, M. Moustapha Ly, Représentant Résident du FMI, a partagé un aperçu des performances économiques du Niger. Malgré une croissance projetée à 6,6 % en 2025 grâce aux exportations de pétrole brut et à la relance de l’agriculture, les contraintes budgétaires, la détérioration du secteur bancaire et les restrictions de financement continuent de peser lourdement sur la mise en œuvre des politiques sociales.Une mobilisation renforcée de la Banque mondiale pour soutenir les priorités nationalesPrenant la parole lors de cette rencontre, M. Hans Fraeters, Représentant Résident de la Banque mondiale au Niger, a mis en exergue les principaux axes d’intervention de la Banque mondiale, alignés sur les priorités nationales, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des infrastructures résilientes. À l’approche de la FFD4, il a insisté sur l’importance d’une coopération renforcée pour maximiser l’impact des investissements, soutenir les réformes structurelles et renforcer la résilience économique du pays dans un contexte régional complexe. L’état d’avancement des ODD : entre progrès et défisLa Représentante Résidente du PNUD, Dr. Nicole Kouassi, a dressé un état des lieux des ODD au Niger. Bien que des progrès soient notés dans les domaines de la gouvernance, de l’environnement et des partenariats (ODD 11, 13, 15, 16, 17), plusieurs indicateurs, notamment ceux liés à l’éducation, à l’accès à l’eau et à l’emploi, stagnent ou régressent. Le Niger a contextualisé 16 des 17 ODD et établi des mécanismes de suivi rigoureux. Toutefois, des inégalités persistantes et la fragilité des services de base nécessitent une action accélérée et des investissements ciblés. Une voix forte du Niger à SévilleÀ travers cette rencontre, le Niger affine sa position pour porter une voix forte lors de la FFD4. La Coordonnatrice Résidente, Mme Mama Keita, a rappelé l’importance de renforcer les partenariats et d’aligner les mécanismes de financement avec les ambitions nationales, tout en appelant à plus de solidarité envers les pays vulnérables.Contact presse :
Bureau du Coordonnateur Résident, Système des Nations Unies au Niger
Aminta Hassimi LarabouSpécialiste en Communication et PlaidoyerBureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations UniesCell : (227) +227 80 07 97 73. Email: aminta.hassimi@un.orghttps://niger.un.org/fr . https://twitter.com/SNU_niger
Bureau du Coordonnateur Résident, Système des Nations Unies au Niger
Aminta Hassimi LarabouSpécialiste en Communication et PlaidoyerBureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations UniesCell : (227) +227 80 07 97 73. Email: aminta.hassimi@un.orghttps://niger.un.org/fr . https://twitter.com/SNU_niger
1 / 5
Communiqué de presse
25 mars 2025
La Coordonnatrice humanitaire au Niger condamne avec indignation l’attaque meurtrière contre des civils dans la région de Tillabéri.
« Je suis profondément bouleversée par cette attaque d’une violence inouïe. Les populations civiles doivent être protégées en toutes circonstances. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et affirme le soutien indéfectible de la communauté humanitaire aux populations touchées par violence au Niger », a déclaré Madame Keita.Depuis des années, la région de Tillabéri subit les assauts récurrents des groupes armés, causant des déplacements massifs et une détérioration grave des conditions de vie des populations civiles. Ces violences exacerbent la vulnérabilité des communautés et entravent l’accès vital à l’aide humanitaire.« Le meurtre de civils est injustifiable. J’exhorte tous les acteurs à respecter le droit international humanitaire, à prendre des mesures immédiates pour protéger les civils et à traduire les responsables de ces actes odieux en justice », a ajouté Madame Keita.La communauté humanitaire, en collaboration avec le Gouvernement du Niger, reste pleinement mobilisée pour répondre aux besoins urgents des populations affectées, en respectant les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.
1 / 5
Communiqué de presse
30 juillet 2024
L'UNOPS et la Banque mondiale améliorent l'accès à une éducation de qualité au Niger
●L'UNOPS et la Banque mondiale ont remis 7 000 tablettes et 7 000 power banks solaires au ministère de l'Éducation nationale du Niger. ● Ces équipements visent à améliorer les pratiques et les méthodes d'enseignement, notamment dans les zones rurales sans accès à l'internet ou à l'électricité. Une formation pour 300 formateur·rices en TIC sera organisée pour assurer la maintenance et l'utilisation optimale des tablettes dans les écoles. NIAMEY, Niger, le 25 juillet 2024 - Dans le cadre du Projet amélioration des apprentissages pour l'obtention de résultats dans l'éducation au Niger (LIRE), financé par la Banque mondiale, l’UNOPS a organisé une cérémonie officielle pour remettre 7 000 tablettes et 7 000 power banks solaires au ministère de l’Éducation nationale du Niger. Cette initiative vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les filles et les garçons au Niger et à renforcer la qualité de l’enseignement en diversifiant les plateformes d’apprentissage. La cérémonie, qui s’est tenue à l’École Normale de Niamey, a été présidée par le secrétaire général adjoint du Ministère de l’Éducation nationale du Niger, Idi Abdou, en présence de la délégation de la Banque mondiale, des partenaires nationaux ainsi que des bénéficiaires. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration des apprentissages pour l'obtention de résultats dans l'éducation au Niger (LIRE, Learning Improvement for Results in Education Project en Anglais) financé par la Banque mondiale. Ce projet vise à aider le gouvernement nigérien à améliorer l’accès à l’éducation, la qualité de l’enseignement et de l’environnement d’apprentissage, tout en renforçant la planification et la gestion de l’éducation au Niger. Avec un budget total de 6,3 millions de dollars de la Banque mondiale, l'acquisition de ces tablettes et power banks solaires a été confiée à l’UNOPS en mai 2023. Ces équipements sont essentiels pour améliorer les pratiques et les méthodes d’enseignement en garantissant la disponibilité de matériel pédagogique pertinent dans les salles de classe. Plus que de simples appareils électriques, ces tablettes et leurs power banks solaires permettront de combler le fossé de l'analphabétisme numérique et de réduire la fracture numérique, grâce à la disponibilité d'un module hors ligne qui permet un déploiement en particulier dans les zones rurales où il n'y a pas d'accès à l'internet ou à l’électricité. Houcem Agrebi, répresentant de l’UNOPS, a ajouté: « Ces équipements [...] constituent un levier important pour la révolution numérique dans le système éducatif nigérien, et un passage obligé vers le développement durable et inclusif. » Pendant les 14 mois de mise en oeuvre, l'UNOPS a utilisé les ressources reçues de ses partenaires de manière efficace, efficiente, transparente et responsable, suivant son expertise et son manuel des achats. Cela a permis de réaliser des économies substantielles de 1,5 million de dollars, qui seront réinvesties pour l’achat de tablettes supplémentaires afin de promouvoir davantage l'apprentissage pour les filles et les garçons dans des situations difficiles au Niger. Le ministère de l’Éducation nationale distribuera ces tablettes et les power banks solaires aux enseignant·es à travers le pays. Avant leur déploiement dans les écoles, l’UNOPS organisera une formation avec 300 formateur·rices en Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) pour assurer la bonne utilisation et la durabilité des appareils livrés. Idi Abdou, secrétaire général adjoint du Ministère de l’Éducation nationale du Niger, a déclaré: « Les enseignants auront désormais accès à des outils modernes pour enrichir leur enseignement, tandis que les élèves pourront bénéficier d’une éducation plus interactive et axée sur les technologies. » Coordonnées pour la presse : Pour plus de détails sur ce projet et/ou pour interviewer un.e spécialiste de l’UNOPS, veuillez contacter Juyoung LEE, chargée de communication au bureau multi-pays de l’UNOPS au Sénégal: juyoungl@unops.org, +221 77 321 88 86. À propos de l’UNOPS La mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés et à aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. L’UNOPS aide les Nations Unies, des gouvernements et d’autres partenaires à gérer des projets et à mettre en place des infrastructures durables et des processus d’achats responsables de façon efficace. Pour en savoir plus, consultez le www.unops.org/fr et suivez l’UNOPS sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et WhatsApp.
1 / 5
Communiqué de presse
28 juin 2024
La Banque mondiale soutient la sécurité alimentaire et la résilience climatique des ménages nigériens
La Banque mondiale a approuvé ce jour un financement destiné à soutenir les secteurs de l’agriculture et de l’élevage au Niger afin qu’ils deviennent plus productifs, bénéficient d’un meilleur accès aux marchés et stimulent les investissements du secteur privé. Le programme renforcera la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages nigériens ainsi que leur résilience au changement climatique.Le Projet de modernisation de l’élevage et de l’agriculture (LAMP) bénéficiera d’une enveloppe de financement de l’Association internationale de développement (IDA)* pouvant atteindre 1 milliard de dollars, étalée sur 12 ans et répartie en trois phases se chevauchant. Au cours de la phase 1, qui s’étend jusqu’en 2029 et équivaut à 350 millions de dollars, le projet investira dans des technologies et innovations climato-intelligentes, des systèmes d’irrigation et de bonnes pratiques agricoles et pastorales.Au Niger, l’agriculture représente près de 40 % du produit intérieur brut du pays et emploie plus de 80 % de la population. Le secteur est très largement tributaire des précipitations. Or celles-ci en raison du changement climatique diminuent et deviennent moins prévisibles, tandis que les températures augmentent. La désertification et l’augmentation de la fréquence des sécheresses et des inondations ont des effets dévastateurs sur les cultures et le bétail. Plus de 3,4 millions de Nigériens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë.« Le Niger a la population qui croît le plus rapidement au monde et qui voit ses terres arables diminuer à un rythme extrêmement rapide en raison du changement climatique. La réduction de la dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale de subsistance est donc un programme de développement urgent, mais à long terme », a déclaré Han Fraeters, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger. « Heureusement, le potentiel d’irrigation du Niger est très important, ce qui signifie que la sécurité alimentaire de la population peut être assurée. Ce programme permettra d’améliorer sensiblement la productivité agricole et animale. Il soutiendra le développement de l’irrigation – 18 000 ha au cours de la première phase seulement. Il permettra également d’améliorer les semences et les races de bétail, et de faciliter l’accès des entrepreneurs à des financements. »Dans le cadre de sa phase 1, le Projet LAMP devrait permettre d’augmenter les rendements des principales cultures et le volume commercialisé de produits agricoles et d’élevage. Le projet renforcera la résilience climatique de 1,5 million de personnes, dont 500 000 jeunes et près de 700 000 femmes et filles.D’ici la fin du programme, 5 millions de personnes devraient avoir renforcé leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, et 3 millions de personnes auront renforcé leur résilience aux risques climatiques. Ce programme ambitieux permettra d’améliorer considérablement la productivité agricole et animale et de transformer le secteur.L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l’IDA apportent des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de personnes. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements s’est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique.
1 / 5
Communiqué de presse
19 juin 2024
Laws and practices on asylum must resist politics of fear and exclusion: UN rights experts GENEVA
(19 June 2024) – Ahead of World Refugee Day tomorrow, the Platform of Independent Experts on Refugee Rights (PIERR) – a group of UN and regional human rights experts and mandate holders – issued the following statement: “Across the world many countries and communities are providing courageous examples of welcoming refugees, showing how the right to seek asylum can be guaranteed and implemented in ways that empower refugees and enable them to contribute fully to their host communities. But in other places, many laws, policies and practices restrict asylum and are rooted in the politics of fear and exclusion. In a year when over 80 countries will conduct elections, xenophobic and racist language has worsened. Asylum-seekers and refugees have become scapegoats for political gain; the suffering of children, women and men forced to flee their homes has been trivialised or ignored. This World Refugee Day, we urge States to work together to protect the critical, fundamental rights of people to seek and enjoy asylum and counteract the backsliding toward erosion of key human rights principles. This means rejecting and desisting from actions and policies such as externalisation of asylum procedures, the arbitrary detention of asylum-seekers, collective expulsions and pushbacks at land and sea. States must uphold human rights and other international law obligations, including the customary international law principle of non-refoulement, which prohibits a State from returning someone to a country where his or her life or freedom would be threatened, or where he or she would face torture, cruel, inhuman or degrading treatment, punishment, irreparable harm or danger. The 1948 Universal Declaration of Human Rights – the 75th anniversary of which was commemorated globally in December 2023 – recognised the right to seek and enjoy asylum as a fundamental human right rooted in our shared humanity and the right to protection. The Universal Declaration inspired the 1951 Refugee Convention and a number of key international and regional binding human rights instruments. These provide protection to people forced to flee their countries and reflect the shared responsibility of States to protect, promote, respect and fulfil their rights. We encourage all States that have not yet done so to ratify the relevant human rights and refugee law instruments and withdraw reservations that limit protections for refugees and asylum-seekers and impede the full enjoyment of their fundamental rights. We call on all States to recognise and reinforce our shared legal responsibility to uphold and protect the human rights of people forced to flee. We stand ready to cooperate with States and the international community in the common quest for a world where no one is forced to flee across borders for their lives and freedom. As we approach the Summit of the Future, we must work together to protect the human right to seek asylum, and to build inclusive, equitable societies that welcome, protect and respect the rights of refugees.” ENDS The PIERR is currently composed of the United Nations Special Rapporteurs on the human rights of migrants and on trafficking in persons, especially women and children, the Working Group on arbitrary detention, the UN Committee against torture, the Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, internally displaced persons and migrants in Africa of the African Commission on Human and Peoples’ Rights and the Rapporteurship on Human Mobility of the Inter-American Commission on Human Rights. The Platform is supported by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and UNHCR, the UN Refugee Agency. Siobhán Mullally, PIERR Chair and UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children; Gehad Madi, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants; Matthew Gillett (Chair-Rapporteur) and Priya Gopalan (Vice-Chair on Follow-Up), UN Working Group on arbitrary detention; Selma Sassi-Safer, Commissioner and Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, internally displaced persons and migrants in Africa of the African Commission on Human and Peoples’ Rights; Andrea Pochak, Commissioner and Rapporteur on Human Mobility of the Inter-American Commission on Human Rights. For additional information and media requests please contact: • OHCHR: Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org) or Federica Donati (federica.donati1@un.org). • UNHCR: Shabia Mantoo (mantoo@unhcr.org +41 79 337 7650) or Kelleen Corrigan (corrigak@unhcr.org).
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
22 septembre 2024
Ressources
24 janvier 2024
1 / 11