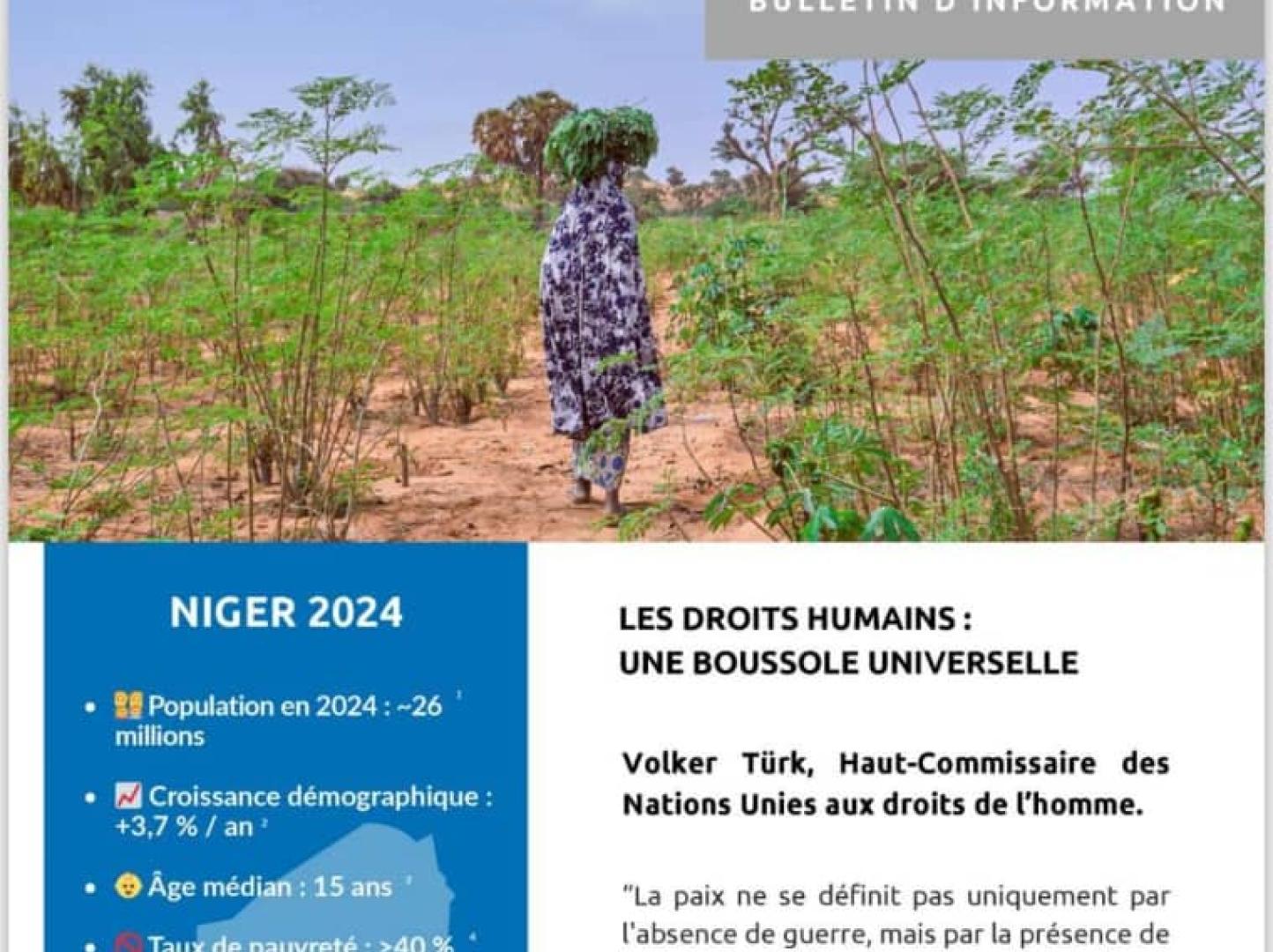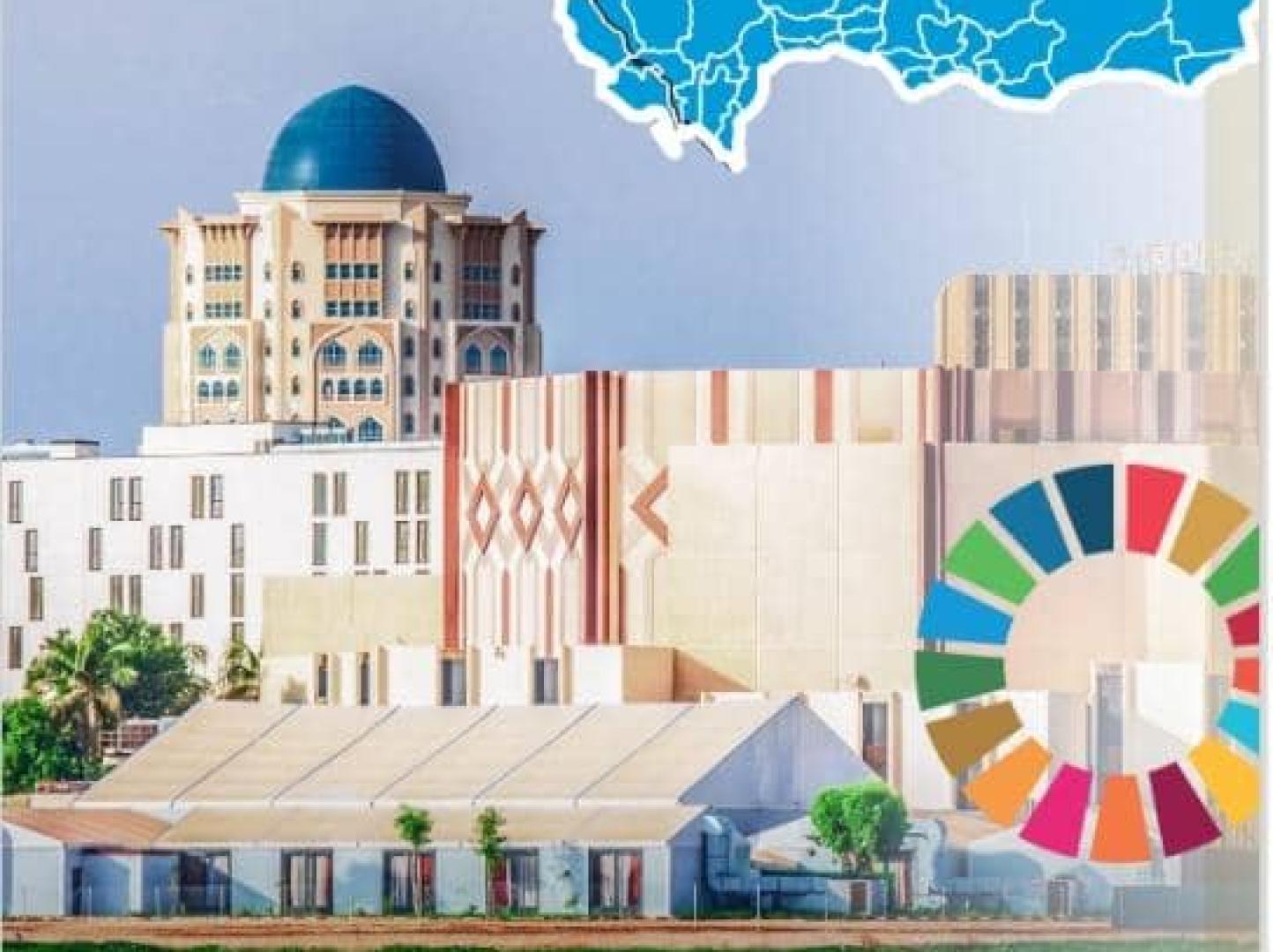Dernières actualités
Histoire
16 janvier 2026
Former pour mieux décider : la plateforme ILLIMI au cœur de la coordination et de la sécurité humaine au Niger
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
14 janvier 2026
Le Niger progresse vers une éducation accessible et de qualité
Pour en savoir plus
Histoire
05 janvier 2026
Dialogue intergénérationnel au Niger : un levier stratégique pour la refondation nationale
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Niger
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Niger:
Histoire
17 novembre 2025
Marathon Novembre Bleu au Niger
Ce 15 novembre, Niamey a vibré au rythme de la Marche de Novembre Bleu, une initiative organisée par la Clinique Afoua et le Mouvement Toastmaster Niger, en partenariat avec plusieurs institutions engagées dans la promotion de la santé masculine. Mme Keita, accompagnée du personnel du Système des Nations Unies, a marché aux côtés de hauts responsables étatiques, témoignant d’un engagement collectif exemplaire.Autour des organisateurs principaux notamment la Clinique Afoua et le Mouvement Toastmaster, se sont fédérés plusieurs partenaires clés :Les Autorités nationales, affirmant un engagement politique fort ;La Faculté des Sciences de la Santé, apportant un éclairage académique et scientifique ;La Banque Régionale des Marchés (BRM), démontrant la responsabilité sociale du secteur privé ; En marge de la marche, Mme MAMA KEITA a accordé une interview aux médias, dont Univers TV, soulignant l’importance de la sensibilisation :
« Notre présence massive n’est pas seulement symbolique. Elle est un appel clair à l’action. La sensibilisation est notre première ligne de défense contre le cancer de la prostate, et c’est en unissant les forces publiques, privées et associatives que nous pourrons réellement sauver des vies. »Le cancer de la prostate demeure un enjeu majeur de santé publique au Niger. À travers cette initiative, les organisateurs et partenaires ont encouragé le dépistage précoce, la prévention et un dialogue plus ouvert sur la santé masculine. Bien plus qu’un simple rassemblement, cette marche de Novembre Bleu incarne un modèle de partenariat public-privé-associatif au service d’une cause vitale. Elle amorce une dynamique qui promet de renforcer les efforts de dépistage, d’information et de sensibilisation à travers le pays.
Ensemble, continuons à sensibiliser, prévenir et sauver des vies. Ecrit par Abdoulkarim Mamane: Assistant en communication au RCOEnsemble, brisons les tabous. Ensemble, prenons soin de la santé des hommes.
« Notre présence massive n’est pas seulement symbolique. Elle est un appel clair à l’action. La sensibilisation est notre première ligne de défense contre le cancer de la prostate, et c’est en unissant les forces publiques, privées et associatives que nous pourrons réellement sauver des vies. »Le cancer de la prostate demeure un enjeu majeur de santé publique au Niger. À travers cette initiative, les organisateurs et partenaires ont encouragé le dépistage précoce, la prévention et un dialogue plus ouvert sur la santé masculine. Bien plus qu’un simple rassemblement, cette marche de Novembre Bleu incarne un modèle de partenariat public-privé-associatif au service d’une cause vitale. Elle amorce une dynamique qui promet de renforcer les efforts de dépistage, d’information et de sensibilisation à travers le pays.
Ensemble, continuons à sensibiliser, prévenir et sauver des vies. Ecrit par Abdoulkarim Mamane: Assistant en communication au RCOEnsemble, brisons les tabous. Ensemble, prenons soin de la santé des hommes.
1 / 5

Histoire
18 octobre 2025
Lancement des commémorations des 80 ans de l’ONU et des 65 ans de coopération avec le Niger par un Écho jogging pour la paix
Dans le cadre du 80e anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies et du 65e anniversaire de la coopération Niger-ONU, le Système des Nations Unies au Niger, en collaboration avec le Stade Général Seyni Kountché, a organisé un Écho jogging – marche sportive reliant la Maison des Nations Unies au Stade Général Seyni Kountché.Diplomates, fonctionnaires en activité, retraités du Système des Nations Unies, partenaires institutionnels et de nombreux enfants d’agents onusiens ont marché côte à côte, unis par le même élan de paix et de solidarité. Dans une ambiance à la fois sportive et fraternelle, les participants ont répondu présent à cet appel du vivre-ensemble, symbole fort des valeurs universelles que promeut l’ONU depuis huit décennies. Le top départ a été donné par Mme Mama Keita, Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Niger, aux côtés de l’Administrateur délégué de la Ville de Niamey, le Colonel Boubacar Soumana Garanké, du Directeur général du Stade Général Seyni Kountché, Ary Issaka Ousmane Gaoh, et de plusieurs responsables d’agences onusiennes. Placée sous le signe du sport, de la santé et de la solidarité, la matinée a débuté par l’allocution de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies, suivie des conseils de sécurité délivrés par l’UNDSS, afin de garantir la bonne tenue de l’activité. Partie de la Maison des Nations Unies, la caravane a emprunté la place Mohamed VI et le rond-point de l’ENA avant d’atteindre le Stade Général Seyni Kountché, dans une ambiance conviviale, énergique et rythmée, lillustrant l’engagement commun à promouvoir la paix, la santé et le vivre-ensemble. À l’arrivée, les participants ont pris part à une séance de près d’une heure de fitness, marquée par la joie, le dynamisme et la motivation générale. Prenant la parole, Mme Mama Keita a livré un message vibrant d’émotion et de lucidité : « En cette année 2025, je préfère parler de commémoration plutôt que de célébration. Parce qu’avec la réduction des moyens, beaucoup de nos collègues ont dû partir, et sans eux, nous ne pouvons parler de fête. Mais 80 ans d’existence, 65 ans de coopération avec le Niger, cela se commémore avec dignité et gratitude . « Ils ont compris que la paix n’était ni une utopie, ni un luxe, mais plutôt une nécessité absolue. »
Un message fort, en parfaite cohérence avec l’esprit de cette célébration, rappelant que le sport est aussi un instrument de paix, de prévention et de cohésion sociale. Elle a rappelé que les fondateurs de l’ONU, sortis des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, avaient bâti cette organisation sur la conviction que « la paix n’est pas un luxe, mais une nécessité absolue ».
Dans un ton à la fois solennel et chaleureux, la Coordinatrice résidente a également salué la diversité des participants venus de tous les continents, soulignant que cette pluralité incarne l’esprit même des Nations Unies : « Aujourd’hui, nous marchons ensemble pour continuer d’éclairer le chemin de la paix. La paix n’a pas de prix, l’unité n’a pas de prix. Continuons de marcher ensemble, pour la paix et pour un monde meilleur à transmettre à nos enfants ». Des autorités locales engagées aux côtés de l’ONUL’Administrateur délégué de la Ville de Niamey, le Colonel Boubacar Soumana Garanké, a salué cette initiative, symbole de vitalité et de solidarité : « Cette journée marque le début des activités du 80e anniversaire du Système des Nations Unies et du 65e anniversaire de sa coopération avec le Niger. Pendant plus d’une demi-heure, les participants ont marché dans la joie, démontrant l’importance du sport pour un corps sain et un esprit sain ». Il a par ailleurs encouragé les participants à profiter du dépistage gratuit du diabète et de la tension artérielle offert sur place, un geste salué par de nombreux participants.De son côté, le Directeur général du Stade Général Seyni Kountché, Ary Issaka Ousmane Gaoh, a exprimé la fierté du stade d’accueillir une telle initiative : « Cette activité s’inscrit pleinement dans notre mission : le sport dans la paix, par la paix et pour la santé. Le stade restera ouvert à ce type d’événements, car il incarne les valeurs de fraternité et de bien-être que nous partageons avec les Nations Unies ».Le représentant de l’OMS au Niger, Dr Casimir Manengu, a, lui aussi, rappelé l’importance du bien-être comme fondement de toute action : « Sans le bien-être, on ne peut rien faire. C’est pour cela que nous avons tenu à être là, pour se relaxer, se ressourcer et être prêts pour la suite des activités ». « Nous sommes dans l’obligation de laisser à nos enfants un monde meilleur que celui que nous avons reçu. Prônons la paix, prônons l’unité, et restons unis dans l’action ». En marge de l’activité Écho Jogging, des stands de dépistage gratuit du diabète et de la tension artérielle ont été installés sur le site. Cette initiative, appuyée par la Clinique des Nations Unies, visait à promouvoir le bien-être du personnel et à encourager l’adoption de modes de vie sains. De nombreux participants ont ainsi pu bénéficier de conseils médicaux et de consultations de prévention, dans un esprit de solidarité et de promotion de la santé au travail. Crédit photo: Chamsia ChaibouArticle proposé par Chamsia Chaibou, Assistante communication au PBF Niger
Un message fort, en parfaite cohérence avec l’esprit de cette célébration, rappelant que le sport est aussi un instrument de paix, de prévention et de cohésion sociale. Elle a rappelé que les fondateurs de l’ONU, sortis des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, avaient bâti cette organisation sur la conviction que « la paix n’est pas un luxe, mais une nécessité absolue ».
Dans un ton à la fois solennel et chaleureux, la Coordinatrice résidente a également salué la diversité des participants venus de tous les continents, soulignant que cette pluralité incarne l’esprit même des Nations Unies : « Aujourd’hui, nous marchons ensemble pour continuer d’éclairer le chemin de la paix. La paix n’a pas de prix, l’unité n’a pas de prix. Continuons de marcher ensemble, pour la paix et pour un monde meilleur à transmettre à nos enfants ». Des autorités locales engagées aux côtés de l’ONUL’Administrateur délégué de la Ville de Niamey, le Colonel Boubacar Soumana Garanké, a salué cette initiative, symbole de vitalité et de solidarité : « Cette journée marque le début des activités du 80e anniversaire du Système des Nations Unies et du 65e anniversaire de sa coopération avec le Niger. Pendant plus d’une demi-heure, les participants ont marché dans la joie, démontrant l’importance du sport pour un corps sain et un esprit sain ». Il a par ailleurs encouragé les participants à profiter du dépistage gratuit du diabète et de la tension artérielle offert sur place, un geste salué par de nombreux participants.De son côté, le Directeur général du Stade Général Seyni Kountché, Ary Issaka Ousmane Gaoh, a exprimé la fierté du stade d’accueillir une telle initiative : « Cette activité s’inscrit pleinement dans notre mission : le sport dans la paix, par la paix et pour la santé. Le stade restera ouvert à ce type d’événements, car il incarne les valeurs de fraternité et de bien-être que nous partageons avec les Nations Unies ».Le représentant de l’OMS au Niger, Dr Casimir Manengu, a, lui aussi, rappelé l’importance du bien-être comme fondement de toute action : « Sans le bien-être, on ne peut rien faire. C’est pour cela que nous avons tenu à être là, pour se relaxer, se ressourcer et être prêts pour la suite des activités ». « Nous sommes dans l’obligation de laisser à nos enfants un monde meilleur que celui que nous avons reçu. Prônons la paix, prônons l’unité, et restons unis dans l’action ». En marge de l’activité Écho Jogging, des stands de dépistage gratuit du diabète et de la tension artérielle ont été installés sur le site. Cette initiative, appuyée par la Clinique des Nations Unies, visait à promouvoir le bien-être du personnel et à encourager l’adoption de modes de vie sains. De nombreux participants ont ainsi pu bénéficier de conseils médicaux et de consultations de prévention, dans un esprit de solidarité et de promotion de la santé au travail. Crédit photo: Chamsia ChaibouArticle proposé par Chamsia Chaibou, Assistante communication au PBF Niger
1 / 5

Histoire
20 mars 2025
Stimuler la production agricole pour multiplier les opportunités pour les communautés
Installée sur une pile de sacs de mil dans le village de Sarkin Hatsi, dans le sud du Niger, Sa'a Moussa esquisse un sourire de fierté. Aujourd'hui, c'est jour de livraison et, à l'entrepôt de sa coopérative composée exclusivement de femmes, elle attend avec impatience l'arrivée des camions qui viendront chercher leur récolte."Cela n'a pas toujours été le cas. Nous venons de loin", dit-elle en évoquant le parcours des 820 membres de l'association agricole Hadin Kan Mata (ODD5) qu'elle dirige, dans la région de Maradi.« Depuis longtemps, nous devons affronter des saisons qui changent de manière imprévisible. La pluie arrive, nous nous dépêchons de semer, puis la sécheresse frappe à nouveau, et nous perdons tout », souligne-t-elle, décrivant la lutte quotidienne de ces femmes contre les chocs climatiques.Dans la région de Maradi, comme dans de nombreuses zones au Niger, les agriculteurs font face à de nombreux défis, y compris la désertification accélérée et dégradation des sols. Le pays perd environ 100 000 hectares de terres chaque année. Ce qui représente un frein à l’atteinte de l’objectif de développement durable « Faim Zéro » (ODD 2). « Les pluies commencent plus tard et s’arrêtent souvent tôt, perturbant le cycle de production agricole de trois mois et réduisant les rendements », explique Ramatou Hinsa, Chargée du développement rural au Programme alimentaire mondial dans la région de Maradi.Les effets des chocs climatiques réduisent la production et menacent la sécurité alimentaire, ce qui pousse de nombreux hommes à chercher des opportunités ailleurs.« Beaucoup de nos hommes migrent vers le Nigeria ou l’Europe via la Libye, souvent sans revenir avant des années, voire jamais. Cela laisse les familles, surtout les femmes et les enfants, dans une grande vulnérabilité », affirme Sa’a Moussa.S’armer pour affronter les effets des chocs climatiquesDepuis 2012, le PAM collabore avec le gouvernement du Niger, les communautés et les organisations locales (ODD 17) pour aider les petits agriculteurs à accéder à des ressources et connaissances essentielles afin d’accroître leur production et leurs compétences entrepreneuriales. Outre les chocs climatiques, ces agriculteurs doivent faire face à l’accès limité aux intrants, aux marchés et au financement.« C’est une approche globale, de la récupération des terres à l’autonomisation des petits exploitants avec des compétences et des outils post-récolte, en passant par la recherche de débouchés pour leurs produits », précise Ramatou.Plus de 300 000 hectares de terres dégradées ont été récupérées par le PAM depuis 2014. À Maradi, le PAM travaille avec la Chambre régionale d’agriculture de Maradi pour proposer des solutions adaptées aux besoins des petits producteurs et entrepreneurs de la région."Nous soutenons les petits agriculteurs en formalisant leurs organisations, en leur fournissant des informations sur les marchés et le climat, et en renforçant leur visibilité par le biais de salons et de foires", explique Guéro Magala, secrétaire général permanent de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi.En conséquence, les agriculteurs ont vu leurs rendements s'accroître. "Grâce à la formation et aux semences améliorées, nos récoltes ont triplé. Auparavant, un hectare produisait 187,5 kg de mil ; aujourd'hui, il en produit de 750 kg à 1 000 kg", explique Moussa, présidente de la coopérative.Dynamiser l’économie locale et l’alimentation scolaireLes bonnes récoltes créent un excédent, permettant à la coopérative Hadin Ka Mata de trouver de nouvelles opportunités commerciales. « Nos produits ont bien marché grâce au soutien du PAM. Aussi, notre coopérative à Maradi a un contrat annuel avec le gouvernement », déclare Sa’a Moussa.« Grâce aux revenus de nos ventes, nos familles peuvent non seulement se nourrir à nouveau, mais surtout profiter de la vie et rêver à nouveau », annonce-t-elle avec joie.Cette initiative du PAM s’inscrit dans la stratégie nationale du Niger consistant à acheter à ses petits producteurs. Depuis 2013, le PAM a acheté plus de 27 000 tonnes de denrées alimentaires, d’une valeur de plus de 12 millions de dollars, principalement utilisées pour approvisionner les cantines scolaires (ODD 4).« Cette stratégie non seulement promeut les régimes alimentaires locaux, mais est aussi très économique. Elle comble le fossé entre les repas pris à la maison et à l'école, réduisant ainsi les coûts logistiques », explique Salou Abdou, Coordinateur régional des cantines scolaires de Maradi. Ces efforts renforcent la vie communautaire et les moyens de subsistance. « Nous sommes fiers de savoir que ce sont nos propres produits, et non des sources inconnues, qui nourrissent nos enfants à l’école. Ces aliments locaux nourrissent nos familles, et cela nous remplit de satisfaction », confie Elhaj Oumarou, chef du village de Sarkin Hatsi.Ce soutien s’aligne sur les efforts de résilience du PAM pour stimuler la production alimentaire locale dans ses programmes au Niger.Les initiatives du PAM en faveur des petits exploitants agricoles et d'autres communautés vulnérables du Niger sont rendues possibles grâce aux pays suivants: Allemagne, Danemark, États-Unis, France, Norvège et l’Union Européenne
1 / 5

Histoire
18 mars 2025
Garantir un bon départ à travers des Soins maternels et néonatals de qualité
I ll est midi ce mercredi 22 mai 2024, c’est l’heure de visite aux malades au Centre de Santé de la Mère et de l’Enfant (CSME) de Maradi, une région située au centre-sud du Niger, frontalière avec le Nigeria. Ce centre de référence, le seul de la région en matière des soins pour la mère et l’enfant, accueille mères, femmes enceintes, enfants et nouveau-nés. Beaucoup viennent directement, mais la plupart sont référés par les centres de santé périphériques des villages et des districts sanitaires de la région. À l’unité des soins de néonatologie, l’une des plus importantes du centre, les équipes sont à pied d’œuvre. Pendant que certains prennent des constantes et placent des cathéters aux nouveaux admis aux soins, Ali Dayabou, technicien supérieur en soins infirmiers, vérifie les températures des bébés avant de placer un concentrateur d’oxygène à un nouveau-né admis pour détresse respiratoire. Le travail des infirmiers est crucial dans ce centre : ils sont chargés d’administrer les premiers soins aux bébés, de faire le suivi et de veiller à l’amélioration de l’état de santé de ces nouveau-nés dont certains sont nés il y a tout juste quelques heures. « Nous accueillons des bébés nés au centre et des bébés nés avec des complications, référés par d’autres structures de santé comme les maternités et les centres de santé intégrés de la région. Les difficultés concernent surtout les bébés référés. Les cas les plus fréquents que nous recevons sont les bébés prématurés, les bébés ayant un ballonnement abdominal, les enfants gavés avec des décoctions, des cas de malformation, des cas d’infections bactériennes sévères mais aussi des enfants qui refusent de téter. À leur arrivée ici, les mamans ont souffert, les bébés ont souffert, ils arrivent pour la plupart dans un état critique. Notre priorité est d’abord de stabiliser le bébé et, au besoin, de faire appel aux services spécialisés car ici nous avons les spécialistes selon les complications. » confie Dayabou. Dans un centre pareil, la disponibilité des équipements, de médicaments et de personnel formé est la clé de réussite de cette mission cruciale pour sauver des vies. C’est pourquoi, depuis son ouverture en 2011, l’Etat et ses partenaires dont UNICEF sont aux côtés du CSME de Maradi à l’instar des autres centres des autres régions pour apporter l’appui nécessaire en termes de matériel, équipements, intrants et formation au personnel. UNICEF a particulièrement dans le cadre du financement de Monaco déployé d’importants équipements et médicaments pour les soins aux nouveaux né d’une part et d’autres part a appuyé le renforcement des capacités des prestataires dans les centres de santé (CSME, Hôpitaux des Districts et CSI) sur des thématiques portant sur les soins aux nouveaux nés y compris la prise en charge des infections bactériennes sévères là où la référence n’est pas possible (PSBI). Dans le même ordre des relais communautaires ont été formés et ont reçu des connaissances pour détecter et référer aux centres de santé des nouveaux nés présentant des signes de danger. « Auparavant, on avait pas de méthodologie quand il s’agissait de soins essentiels, on faisait tout pêle-mêle. Grâce à la formation, nous avons compris l’importance des soins essentiels dès la naissance, mais aussi qu’il y a des étapes à suivre, comme obtenir les premiers pleurs du bébé, bien faire les soins au cordon... Prendre deux minutes pour prodiguer ces soins peut protéger l’enfant durant des années. » témoigne l’infirmier. Les soins de santé primaires prodigués au nouveau-né immédiatement après sa naissance assurent un bon départ et permettent d’éviter des complications potentielles. Malheureusement, beaucoup de nouveau-nés référés ne bénéficient pas correctement de ces soins. C’est pourquoi, L’UNICEF grâce au financement de la Principauté de Monaco, a soutenu un stage clinique pour les sages-femmes des maternités des districts sanitaires de Maradi afin qu’elles puissent participer à une immersion pratique au CSME sur les soins essentiels aux nouveau-nés. « Beaucoup d’entre elles avaient du mal à trouver les voies veineuses des bébés ou à réaliser d’autres gestes essentiels. Durant le temps passé avec nous, nous avons effectué des réanimations avec elles, nous leur avons appris la méthode de peau à peau, les soins des yeux… » confie Dr Lamine, pédiatre et responsable de l’Unité de Néonatologie.En 2023, cette unité a enregistré plus de 5000 patients, et les coupures d’électricité récentes auraient pu causer des dégâts sans l’installation d’un groupe électrogène et de carburant fourni par l’UNICEF. « C’était vraiment un ouf de soulagement, ce groupe qui nous a permis d’éviter le pire », conclut Dr Lamine.Au-delà du sacrifice quotidien fourni par le personnel pour sauver des enfants entre la vie et la mort, c’est une fierté pour les agents comme Dayabou d’être au chevet de ces bébés et de contribuer à redonner le sourire à leurs mamans : « Voir une mère désespérée repartir avec son bébé dans les bras, toute souriante, nous procure une grande satisfaction morale. »Le Centre de Santé de la Mère et de l’Enfant de Maradi joue un rôle crucial dans la région, offrant des soins de qualité qui sont indispensables aux mères et aux nouveau-nés. Le soutien constant des partenaires est vital pour maintenir et améliorer la qualité des soins prodigués.
1 / 5

Histoire
18 mars 2025
Le parcours résilient des femmes déplacées de Tingara
Depuis l’attaque tragique qui a contraint des centaines de familles à fuir le village de Tingara 2 en février 2019, de nombreuses femmes déplacées ont trouvé refuge dans le site de Tadress, en périphérie de Tillabéri. Face à l’adversité, elles ont su faire preuve d’une résilience remarquable, soutenues par l’ONG JAAD. Leur histoire illustre la force du collectif et l’impact positif qu’une organisation dédiée peut apporter à des communautés en détresse.En février 2019, une attaque d’éléments présumés de Groupes Armés Non-Étatiques (GANE) a frappé le village de Tingara, dans la commune de l’Anzourou. Environ 216 ménages, soit 1 500 personnes dont Mamou Hassimi, 46 ans, mère de cinq enfants et Haoua Issaka, 31 ans et mère de sept enfants, ont fui leurs foyers, abandonnant maisons, terres et moyens de subsistance. Elles ont marché durant quinze jours pour atteindre Tillabéri, bravant la faim, la fatigue et la maladie. « Ce départ forcé reste le pire moment de ma vie ; nombreux sont ceux qui étaient tombés malades ; d’autres n’y ont pas survécu tandis que certains donnèrent la vie au cours de cet odyssée. » – Mamou Hassimi. À Tillabéri, dès leur arrivée, elles furent accueillies par les autorités locales avec une première assistance en vêtements et en nourriture. Par la suite, le Programme alimentaire mondial (PAM), des ONG nationales et internationales leur ont distribué des céréales, de l’huile, du sel et du sucre pour une durée de trois mois. La rencontre avec JAAD : vers l’autonomisationLa vie de ces rescapées de Tingara va changer à partir de 2020, à la suite de leur rencontre avec l’ONG nationale Jeunesse Africaine et Actions de Développement (JAAD), dans le cadre du réseau « West African Network for peacebuilding » (Wanep). Ce fut le début d’une collaboration fructueuse qui aura permis de se constituer en groupement de 33 membres, dénommé « Lakal Kaney ». Ensuite, JAAD a renforcé leurs capacités en vie associative, en sensibilisation sur la cohésion sociale mais aussi en techniques de transformation de produits alimentaires. L’initiative n’a pas tardé à faire des émules, car aussitôt, les femmes de la communauté hôte se sont de leur côté organisées en groupement dénommé « Fahamey » avec 45 membres ; engageant un échange solidaire avec leurs consœurs déplacées. Commence alors une relation forte fondée sur la cohésion sociale entre ces femmes que la providence à mises ensemble ; en témoigne le partage d’expériences et de savoir-faire. « Grâce aux formations en transformation de produits alimentaires et la fabrication de savon, nous pouvons désormais subvenir à nos besoins, assurer la scolarisation de nos enfants et reprendre confiance en nous », a déclaré pour sa part Haoua Issaka. Elles apprirent les unes des autres comment produire du savon liquide et solide, comment transformer du maïs en produits dérivés, comment valoriser de l’arachide en tourteaux et en pâte, et comment transformer des ressources locales comme le sésame, le soumbala et les feuilles de corètes. L’expérience a montré que les réponses aux crises et catastrophes peuvent être encore plus efficaces qu’elles ne le sont, si les programmes d’interventions faisaient davantage attention aux besoins spécifiques de chaque catégorie de personnes affectées par les crises, comme on peut le voir avec JAAD et les femmes de Tadress.Une success story confirmée : la foire de NiameyDébut 2025, JAAD est revenue à Tillabéri pour inviter plusieurs femmes de Tadress à la foire agropastorale et halieutique « Sahel Niger 2025 » à Niamey. Elle les dota de kits d’autonomisation pour renforcer leurs capacités pour ce faire. Et puis à la suite d’un processus de sélection organisé par cette ONG, Mamou, Haoua et deux autres femmes de la communauté hôte de Tadress ont été retenues pour participer à cet événement. « Nous sommes désormais visibles en tant que groupement de la région de Tillabéri dans ce que nous savons faire de mieux en matière de transformation de produits alimentaires ; mais il faut le dire, nous avons aussi beaucoup appris des autres, découvert les produits d’autres groupements et entrepreneures venus de tout le pays et de la sous-région, tissé des liens et développé un réseau de partage d’expériences », a déclaré Marie Doulla, du groupement « Fahamey », membre de la communauté hôte. Cette première participation à un événement d’envergure internationale avait tout l’air d’une consécration pour ces femmes venues de loin. Les femmes sont revenues encore plus motivées, conscientes de l’importance d’améliorer la qualité de leurs produits pour conquérir de nouveaux marchés.Un modèle de résilience et de solidaritéPour Mamou, Haoua et ses compagnes, ce parcours témoigne avant tout de leur détermination face aux crises successives qui touchent la région de Tillabéri. Au-delà de la survie, ces femmes déplacées ont trouvé les ressources pour reconstruire leur vie et s’intégrer dans une nouvelle communauté grâce à la synergie entre JAAD, les autorités locales et d’autres partenaires.« Le 8 mars est une occasion de célébrer les progrès accomplis par les femmes, mais aussi de mettre en lumière l'importance de leur autonomisation dans tous les aspects de la vie. L'aide humanitaire doit impérativement prendre en compte cette réalité en accordant une priorité aux organisations locales dirigées par des femmes, qui sont au cœur des solutions adaptées aux besoins des communautés. En leur fournissant davantage de ressources et de pouvoir d'action, nous contribuons non seulement à renforcer la résilience des populations, mais aussi à faire émerger des leaders féminines, actrices essentielles dans la construction de sociétés plus justes, inclusives et durables », a dit ABDOU IDI Haoua, Coordonnatrice Nationale de l'ONG JAAD, une organisation qui travaille à promouvoir le leadership des femmes au Niger. Cette histoire est un appel à multiplier les actions de soutien aux populations déplacées et à promouvoir l’autonomisation des femmes, levier essentiel pour renforcer la résilience communautaire. Malgré les difficultés, l’expérience de Tingara et de Tadress montre qu’avec un accompagnement adapté, il est possible de retrouver une vie digne et de contribuer activement au développement économique local.Vers l’avenirLe parcours de Mamou, Haoua et des femmes de Tingara met en lumière la force de la solidarité et le rôle essentiel de l’accompagnement dans un contexte de crise. Leur participation à la foire de Niamey confirme qu’en dépit des obstacles, l’audace, la persévérance et le soutien ciblé peuvent ouvrir de nouvelles perspectives à celles et ceux qui ont tout perdu. Plus largement, il s’agit d’une leçon universelle : l’espoir et l’entraide peuvent devenir de puissants moteurs de reconstruction et d’autonomisation.
1 / 5

Histoire
16 janvier 2026
Former pour mieux décider : la plateforme ILLIMI au cœur de la coordination et de la sécurité humaine au Niger
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement de l’utilisation des données pour la prévention, l’atténuation et la réponse aux crises », financé par le United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), et mis en œuvre conjointement par le Gouvernement du Niger et le Système des Nations Unies, avec l’appui technique du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Pourquoi ILLIMI, pourquoi maintenant ?Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, climatiques, humanitaires et de développement, la disponibilité de données fiables, accessibles et partagées constitue un levier essentiel pour anticiper les crises, mieux cibler les interventions et renforcer l’impact des actions collectives. La plateforme ILLIMI répond à cet enjeu en offrant un espace commun de coordination, de suivi et d’analyse, au croisement des priorités du Gouvernement du Niger et des Nations Unies. Plus qu’un outil technologique, ILLIMI se positionne comme un vecteur de transparence, de synergie et de prise de décision fondée sur les données, au service de la sécurité humaine et du développement durable. De la vision à l’action : six sessions pour bâtir une communautéOrganisées dans un esprit de collaboration et de renforcement des capacités, les formations ont réuni des représentants de plusieurs institutions gouvernementales (notamment la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire (MISPAT), la Direction Générale de la Planification et de la Programmation du Développement (DGPPD), la Cellule d’Analyse Stratégique Economique, Financière, Sociale et Environnementale (CASEFSE), l’Agence Nationale pour la Société de l’Information, l’Institut National de la Statistique (INS) et des agences des Nations Unies. Les six sessions ont permis de :Poser les bases de l’appropriation de la plateforme :Consolider ces acquis à travers une pratique approfondie : croisement d’indicateurs, visualisation multi-sectorielle, publication de documents et d’articles, et analyse des financements du Système des Nations Unies par région, secteur et Objectifs de Développement Durable (ODD). Mettre l’accent sur la coordination inter-agences, l’édition de contenus, la création d’événements et l’utilisation stratégique des données de financement pour appuyer la communication et le reporting.Apprendre en faisant : des données qui prennent vieTout au long des sessions, les participants ont activement exploré, analysé et croisé les données disponibles sur ILLIMI. Les exercices pratiques et les échanges collectifs ont permis de mieux comprendre la lecture des visualisations, la valeur ajoutée de ILLIMI, ainsi que les opportunités offertes par la plateforme pour améliorer la coordination et le partage d’informations. Ce que disent les participants« Belle initiative et engagement des parties prenantes à la hauteur »« La plateforme est très riche et permet à des acteurs de la consolidation de la paix que nous sommes d'avoir accès à des données fiables et disponibles »« Merci pour cette formation excellente dans l'ensemble et très importante pour le rapportage »Un partenariat Gouvernement–Nations Unies au service de l’impactCes sessions de formation illustrent une collaboration concrète et renforcée entre le Gouvernement du Niger et les Nations Unies, fondée sur la complémentarité, la confiance et la recherche de synergies. Elles contribuent directement à l’opérationnalisation des principes de l’UN 2.0 et de la sécurité humaine, en investissant dans des capacités durables et une culture de travail fondée sur les données.
ILLIMI s’affirme ainsi comme un instrument structurant de coordination, au service de politiques publiques plus informées, plus cohérentes et plus efficaces.Former aujourd’hui, c’est mieux décider demain.
Un investissement durable pour des réponses plus rapides, plus ciblées et plus impactantes au bénéfice des populations nigériennes. Ecrit par, Florence Fatouma AFAGNIBODevelopment Coordination Officer, Data Management And Results Monitoring & Reporting RCO NIGER
ILLIMI s’affirme ainsi comme un instrument structurant de coordination, au service de politiques publiques plus informées, plus cohérentes et plus efficaces.Former aujourd’hui, c’est mieux décider demain.
Un investissement durable pour des réponses plus rapides, plus ciblées et plus impactantes au bénéfice des populations nigériennes. Ecrit par, Florence Fatouma AFAGNIBODevelopment Coordination Officer, Data Management And Results Monitoring & Reporting RCO NIGER
1 / 5

Histoire
05 janvier 2026
Dialogue intergénérationnel au Niger : un levier stratégique pour la refondation nationale
Le Niger fait face à une combinaison de défis structurels majeurs : une forte pression démographique caractérisée par une population majoritairement jeune, la fragilisation des liens sociaux, des crises sécuritaires et économiques persistantes, ainsi qu’une recomposition profonde des repères sociaux et institutionnels. Dans ce contexte, l’écart croissant entre les générations, s’il n’est pas comblé par un dialogue constructif, risque d’affaiblir la confiance mutuelle, la solidarité nationale et la capacité collective à bâtir des réponses durables aux défis du pays. Une initiative inédite au service de la jeunesse et de la cohésion nationaleOrganisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, avec l’appui du Système des Nations Unies, la rencontre nationale du dialogue intergénérationnel constitue une première au Niger. Elle marque une avancée significative dans le processus de refondation nationale en mettant en valeur l’un des atouts majeurs du pays : sa jeunesse.Placée sous le thème « Transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales de l’identité nigérienne pour faire d’eux le moteur de la refondation du Niger », cette rencontre offre un cadre d’échanges direct et structuré entre les jeunes et leurs aînés autour des grandes préoccupations nationales. À cette occasion, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed, a souligné que « ce dialogue est une tribune privilégiée pour transmettre à la nouvelle génération les valeurs sacrées de notre identité culturelle ». Un moment charnière pour l’avenir du paysLa tenue de cette rencontre intervient à un moment déterminant de l’histoire du Niger, marqué par un processus de refondation nationale qui requiert l’implication active, concertée et complémentaire de toutes les générations. Créer un espace structuré de dialogue entre jeunes et aînés apparaît essentiel pour partager les expériences, transmettre les valeurs fondamentales, renforcer l’unité nationale et permettre à la jeunesse de s’approprier la vision et les priorités du pays.Dans ce sens, le Gouverneur de la Région de Niamey, Assoumane Abdou Harounan, a rappelé qu’« il s’agit d’un processus de complémentarité et d’échanges entre les générations, dont la finalité est la transmission de l’éducation, de l’instruction, du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, pour un vivre-ensemble harmonieux ». Le dialogue intergénérationnel comme pilier de paix et de résilienceDans un contexte national en mutation, le dialogue intergénérationnel s’impose comme un levier stratégique pour consolider la paix, renforcer la cohésion sociale et préparer un avenir inclusif et résilient. Le Premier Ministre, Son Excellence Ali Mahaman Lamine Zeine, a pour sa part affirmé : « Nous voulons une jeunesse bien formée, débarrassée de tous les vices, jalouse de notre souveraineté et de notre cohésion nationale ». Une vision partagée et une méthodologie structuréeL’État nigérien, le Système des Nations Unies et l’ensemble des partenaires partagent une vision commune : bâtir un Niger uni, résilient et inclusif, où le dialogue intergénérationnel constitue un pilier essentiel de la cohésion sociale, de la transmission des valeurs et de l’engagement actif de la jeunesse dans la dynamique de refondation nationale.Dans cette perspective, l’UNFPA a présenté une méthodologie structurée de dialogues intergénérationnels, déclinée aux niveaux régional, communal, cantonal et communautaire. Cette approche vise à garantir des échanges inclusifs, représentatifs et constructifs, adaptés aux réalités locales.Construire l’avenir par l’écoute et la co-constructionL’expérience démontre que lorsque les espaces d’écoute sont structurés, inclusifs et respectueux, ils renforcent la confiance entre les générations et contribuent à apaiser les tensions sociales. En favorisant l’écoute mutuelle, la transmission des valeurs et la co-construction de solutions, le dialogue intergénérationnel apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la cohésion sociale et bâtir un avenir plus inclusif et durable pour le Niger. Chamsia Chaibou
Assistante en communication – PBF
Assistante en communication – PBF
1 / 5

Histoire
31 décembre 2025
Parce que vous avez choisi d’être là, l’espoir a continué en 2025 !
En cette fraîche matinée de décembre, à Dangoudaou, un village situé à quelques kilomètres de Matameye dans la région de Zinder, Haoua ouvre la porte de son grenier. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, les sacs sont pleins. Ce grenier bien garni représente bien plus qu’une récolte : il est synonyme de sécurité alimentaire pour sa famille et d’espoir retrouvé après des années marquées par l’incertitude.
Présidente d’une organisation paysanne, Haoua consacre une partie de sa production à l’alimentation de sa famille et le surplus est acheté par des écoles à cantine, avec l’appui du PAM. Elles sont nombreuses, les femmes de cette localité à bénéficier de ce programme d’achats locaux auprès des petits producteurs, qui renforce à la fois les moyens d’existence et l’économie locale.
En 2025, grâce au soutien des bailleurs et en appui au Gouvernement, le PAM et ses partenaires ont contribué à la restauration de 22 400 hectares de terres agricoles et sylvopastorales, 377 kilomètres de bandes pare-feux réalisées pour sécuriser les fortes productions pastorales, répartis sur presque 300 sites dans 1 000 villages. À travers des techniques adaptées aux réalités locales près de 80 000 ménages ont été soutenus, transformant l’assistance en une résilience durable. Dans la même dynamique, le PAM a poursuivi son appui aux petits producteurs en accompagnant 43 organisations paysannes et en achetant 3 648 tonnes de céréales, contribuant ainsi à stabiliser les marchés locaux tout en soutenant les revenus agricoles. Si le grenier plein sécurise les familles pour les mois à venir, l’avenir se construit surtout à l’école, là où un repas peut faire toute la différence. Dans le village d’Angoual Dania, département de Allakaye, région de Diffa, Habiba commence l’après-midi par un déjeuner chaud avec ses camarades. Pour elle, ce repas est souvent le seul équilibré de la journée et surtout la condition pour rester en classe, apprendre et grandir. En 2025, le PAM a servi des repas scolaires à plus de 390 000 élèves, contribuant à l’amélioration de la rétention (maintien) scolaire, des apprentissages et la protection des enfants, tout en allégeant la charge qui sur les familles.
Cependant, pour apprendre, grandir et s’épanouir d’avantage, il faut-il être en bonne santé. Pour les plus jeunes et leurs mères, la nutrition reste une priorité vitale. Dans un centre de santé communautaire du village de Ketchandi à Diffa, Mariama serre son nourrisson contre elle. Grâce à un suivi nutritionnel régulier, elle retrouve peu à peu confiance et espoir pour l’avenir de son bébé. Diffa, cette région qui se relève progressivement des conflits armés, ici les populations hôtes et les communautés déplacées ont appris à vivre ensemble, comme une seule famille. Les centres de santé et la cantine scolaire sont devenus des espaces de stabilité et de protection pour les enfants. Cette année, environ 350 000 enfants âgés de 6 à 23 mois, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes, ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle, contribuant à prévenir et traiter la malnutrition dans les zones où les risques restent les plus élevés au Niger. Parallèlement, des activités de changement de comportement ont été menées autour de l’alimentation du nourrisson, de l’hygiène, de l’utilisation des moustiquaires imprégnées. Ces actions ont permis de toucher 13 289 personnes, dont 8 944 femmes et 4 345 hommes, renforçant durablement les bonnes pratiques au sein des communautés. Lorsque les chocs dépassent les capacités des familles et que la crise force à tout abandonner, l’assistance d’urgence devient alors une question de survie. Dans la région de Tillabéri, Issa a dû fuir son village natal à cause de l’insécurité. Arrivé à Simiri, il pensait avoir tout perdu. L’assistance du PAM lui permet de nourrir sa famille et de retrouver un minimum de stabilité, condition essentielle pour se projeter à nouveau dans l’avenir.
En 2025, le PAM Niger, en appui au Gouvernement, a accompagné plus de 1,2 million de personnes en situation d’urgence, à travers des distributions alimentaires et des transferts monétaires, en ciblant en priorité les populations les plus vulnérables. Par ailleurs, atteindre les populations, souvent isolées par l’insécurité, la distance ou l’état des routes, exige des solutions rapides et adaptées. Lorsque les routes deviennent impraticables, le service aérien humanitaire devient un lien vital. En quelques heures, équipes humanitaires et intrants essentiels atteignent des communautés isolées, là où il fallait auparavant plusieurs jours.
En 2025, UNHAS, ce pont aérien a permis d’assurer la continuité des opérations humanitaires, de renforcer l’accès aux zones difficiles et de garantir une réponse rapide, sûre et efficace au plus près des populations. Dans ce contexte complexe, chaque décision compte et chaque ressource doit produire un impact maximal. Derrière chaque hectare restauré, chaque repas servi, chaque personne vulnérable assisté et chaque enfant pris en charge, il y a un choix stratégique : celui de faire mieux avec des moyens limités. Le PAM a ainsi concentré ses efforts sur les interventions à fort impact, en veillant à une utilisation rigoureuse, transparente et responsable des ressources.
Ces résultats n’auraient toutefois pas été possibles sans une action collective, fondée sur la confiance et le travail conjoint avec l’ensemble des partenaires sous le leadership du gouvernement. Sur le terrain, autorités nationales, partenaires locaux, équipes humanitaires et communautés travaillent main dans la main. Cette confiance partagée permet d’adapter les réponses, d’atteindre les plus vulnérables et de renforcer durablement les capacités locales.Ainsi, de l’urgence à la résilience, du champ à l’école, chaque action s’inscrit dans une même ambition : protéger les plus vulnérables et renforcer leur espoir en l’avenir. Dans un contexte de défis humanitaires et logistiques majeurs, votre soutien a permis de raccourcir les distances, de gagner un temps précieux et, surtout, de sauver des vies et de changer les vies.
Merci aux Autorités Nigériennes, à nos bailleurs :Allemagne, Canada, Danemark, ECHO, Espagne, Etats Unis, Italie, Luxembourg, Monaco, Royaume Uni, Russie, suède, suisse, UNCERF et à nos équipes de terrain de faire la différence, du ciel jusqu’au terrain.
Présidente d’une organisation paysanne, Haoua consacre une partie de sa production à l’alimentation de sa famille et le surplus est acheté par des écoles à cantine, avec l’appui du PAM. Elles sont nombreuses, les femmes de cette localité à bénéficier de ce programme d’achats locaux auprès des petits producteurs, qui renforce à la fois les moyens d’existence et l’économie locale.
En 2025, grâce au soutien des bailleurs et en appui au Gouvernement, le PAM et ses partenaires ont contribué à la restauration de 22 400 hectares de terres agricoles et sylvopastorales, 377 kilomètres de bandes pare-feux réalisées pour sécuriser les fortes productions pastorales, répartis sur presque 300 sites dans 1 000 villages. À travers des techniques adaptées aux réalités locales près de 80 000 ménages ont été soutenus, transformant l’assistance en une résilience durable. Dans la même dynamique, le PAM a poursuivi son appui aux petits producteurs en accompagnant 43 organisations paysannes et en achetant 3 648 tonnes de céréales, contribuant ainsi à stabiliser les marchés locaux tout en soutenant les revenus agricoles. Si le grenier plein sécurise les familles pour les mois à venir, l’avenir se construit surtout à l’école, là où un repas peut faire toute la différence. Dans le village d’Angoual Dania, département de Allakaye, région de Diffa, Habiba commence l’après-midi par un déjeuner chaud avec ses camarades. Pour elle, ce repas est souvent le seul équilibré de la journée et surtout la condition pour rester en classe, apprendre et grandir. En 2025, le PAM a servi des repas scolaires à plus de 390 000 élèves, contribuant à l’amélioration de la rétention (maintien) scolaire, des apprentissages et la protection des enfants, tout en allégeant la charge qui sur les familles.
Cependant, pour apprendre, grandir et s’épanouir d’avantage, il faut-il être en bonne santé. Pour les plus jeunes et leurs mères, la nutrition reste une priorité vitale. Dans un centre de santé communautaire du village de Ketchandi à Diffa, Mariama serre son nourrisson contre elle. Grâce à un suivi nutritionnel régulier, elle retrouve peu à peu confiance et espoir pour l’avenir de son bébé. Diffa, cette région qui se relève progressivement des conflits armés, ici les populations hôtes et les communautés déplacées ont appris à vivre ensemble, comme une seule famille. Les centres de santé et la cantine scolaire sont devenus des espaces de stabilité et de protection pour les enfants. Cette année, environ 350 000 enfants âgés de 6 à 23 mois, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes, ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle, contribuant à prévenir et traiter la malnutrition dans les zones où les risques restent les plus élevés au Niger. Parallèlement, des activités de changement de comportement ont été menées autour de l’alimentation du nourrisson, de l’hygiène, de l’utilisation des moustiquaires imprégnées. Ces actions ont permis de toucher 13 289 personnes, dont 8 944 femmes et 4 345 hommes, renforçant durablement les bonnes pratiques au sein des communautés. Lorsque les chocs dépassent les capacités des familles et que la crise force à tout abandonner, l’assistance d’urgence devient alors une question de survie. Dans la région de Tillabéri, Issa a dû fuir son village natal à cause de l’insécurité. Arrivé à Simiri, il pensait avoir tout perdu. L’assistance du PAM lui permet de nourrir sa famille et de retrouver un minimum de stabilité, condition essentielle pour se projeter à nouveau dans l’avenir.
En 2025, le PAM Niger, en appui au Gouvernement, a accompagné plus de 1,2 million de personnes en situation d’urgence, à travers des distributions alimentaires et des transferts monétaires, en ciblant en priorité les populations les plus vulnérables. Par ailleurs, atteindre les populations, souvent isolées par l’insécurité, la distance ou l’état des routes, exige des solutions rapides et adaptées. Lorsque les routes deviennent impraticables, le service aérien humanitaire devient un lien vital. En quelques heures, équipes humanitaires et intrants essentiels atteignent des communautés isolées, là où il fallait auparavant plusieurs jours.
En 2025, UNHAS, ce pont aérien a permis d’assurer la continuité des opérations humanitaires, de renforcer l’accès aux zones difficiles et de garantir une réponse rapide, sûre et efficace au plus près des populations. Dans ce contexte complexe, chaque décision compte et chaque ressource doit produire un impact maximal. Derrière chaque hectare restauré, chaque repas servi, chaque personne vulnérable assisté et chaque enfant pris en charge, il y a un choix stratégique : celui de faire mieux avec des moyens limités. Le PAM a ainsi concentré ses efforts sur les interventions à fort impact, en veillant à une utilisation rigoureuse, transparente et responsable des ressources.
Ces résultats n’auraient toutefois pas été possibles sans une action collective, fondée sur la confiance et le travail conjoint avec l’ensemble des partenaires sous le leadership du gouvernement. Sur le terrain, autorités nationales, partenaires locaux, équipes humanitaires et communautés travaillent main dans la main. Cette confiance partagée permet d’adapter les réponses, d’atteindre les plus vulnérables et de renforcer durablement les capacités locales.Ainsi, de l’urgence à la résilience, du champ à l’école, chaque action s’inscrit dans une même ambition : protéger les plus vulnérables et renforcer leur espoir en l’avenir. Dans un contexte de défis humanitaires et logistiques majeurs, votre soutien a permis de raccourcir les distances, de gagner un temps précieux et, surtout, de sauver des vies et de changer les vies.
Merci aux Autorités Nigériennes, à nos bailleurs :Allemagne, Canada, Danemark, ECHO, Espagne, Etats Unis, Italie, Luxembourg, Monaco, Royaume Uni, Russie, suède, suisse, UNCERF et à nos équipes de terrain de faire la différence, du ciel jusqu’au terrain.
1 / 5

Histoire
11 décembre 2025
« Tous unis pour mettre fin à la violence numérique à l’égard des femmes et des filles »
ONU Femmes Niger a lancé l’initiative « Oranger les agences du Système des Nations Unies », afin de renforcer l’esprit One UN et de promouvoir une mobilisation collective contre toutes les formes de violences, notamment en ligne.Leader mondial de la campagne des 16 Jours d’activisme, ONU Femmes fédère chaque année gouvernements, institutions, société civile et communautés autour de l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Au Niger, cette dynamique se traduit par l’engagement actif du Système des Nations Unies.L’UNHCR a été la première agence « orangée ». À cette occasion, la Chargée de Programme EVAWG, représentant la Représentante résidente par intérim d’ONU Femmes, a sensibilisé le personnel sur l’ampleur des violences numériques et rappelé l’importance de garantir l’autonomisation digitale des femmes et des filles. Le Représentant du HCR a salué l’initiative en rappelant que « les violences numériques blessent, isolent et détruisent la confiance et la dignité. Oranger le monde, oranger nos espaces et oranger le HCR est un acte symbolique mais essentiel ».La Coordination des Nations Unies (UNRCO) a ensuite été orangée, illustrant la mobilisation collective du SNU pour un environnement numérique sûr et exempt de violence. OCHA s’est également prêté à la dynamique, témoignant de son engagement aux côtés d’ONU Femmes et du SNU pour renforcer la protection des femmes et des filles, en particulier dans les contextes de crise où les risques de violences, y compris numériques, sont exacerbés. Sa participation a contribué à amplifier le message de solidarité et de responsabilité partagée. Cette action conjointe, impulsée par ONU Femmes, réaffirme la volonté du Système des Nations Unies de travailler ensemble pour un Niger où les femmes et les filles sont protégées et autonomisées, en ligne comme hors ligne.
1 / 5

Histoire
11 décembre 2025
Atelier Horizon Scanning – Analyse Commune Pays 2025 : anticiper les risques émergents et préparer l’avenir du Niger
Dans le cadre de l’actualisation 2025 de l’Analyse Commune de Pays (ACP), le Système des Nations Unies au Niger introduit pour la première fois la méthodologie de l’Horizon Scanning. Cet outil innovant vise à identifier les signaux faibles et les tendances émergentes susceptibles d’influencer la trajectoire de développement du Niger à l’horizon 2030. Ce 4 décembre 2025, les membres de l’Équipe Pays des Nations Unies (UNCT) se sont réunis pour un mini-atelier consacré à cet exercice stratégique.Une ouverture axée sur l’analyse prospectiveL’atelier a débuté par l’intervention du Chef de Bureau de l’UNRCO, Dr.Maharouf Oyolola, qui a souligné l’importance de l’Horizon Scanning.
Il a indiqué qu’ il s’agit d’un processus analytique essentiel permettant de produire une lecture indépendante, impartiale et factuelle de la situation politique, sociale, technologiques, économique, légales, sécurité ou humanitaires et environnementale du Niger. Cette démarche constitue une composante clé du plan de coopération entre le Niger et les Nations Unies, en offrant une vision prospective capable d’anticiper les risques et de saisir les opportunités susceptibles d’influencer le développement national d’ici 2030. L'objectif général assigné assigné à cette rencontre est de renforcer la capacité collective du Système des Nations Unies à identifier, analyser et prioriser les signaux faibles et tendances émergentes dans le cadre de l’ACP 2025. De maniere spécifique, l’atelier visait notamment à :Présenter la méthodologie de l’Horizon Scanning ;Examiner les signaux faibles issus de l’analyse contextuelle ;Prioriser les risques et opportunités émergents ;Proposer des mesures d’anticipation et de résilience pour exploiter les opportunités et atténuer les risques ;Renforcer la cohérence analytique inter-agences. À l’issue des travaux, plusieurs livrables ont été consolidés :Une liste structurée de signaux faibles identifiés ;Une analyse prospective des risques et opportunités susceptibles d’influencer le développement du Niger ;Une matrice de priorisation (impact/probabilité) pour hiérarchiser les dynamiques les plus déterminantes ;Des mesures d’anticipation et de résilience permettant de saisir les opportunités et d’atténuer les risques ;Des orientations claires pour la finalisation de l’ACP 2025, avec un alignement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Un exercice collectif et enrichissantCet atelier a constitué un moment d’échanges constructifs, rassemblant les expertises et perspectives des différentes agences du SNU.
L’intégration de l’Horizon Scanning marque une étape importante vers une planification plus prédictive, agile et cohérente, en alignement avec le UN 2.0 afin d’accompagner le Niger dans la construction d’un avenir plus résilient, inclusif et durable.Ecrit par Chamsia Chaibou, Assistante en Communication au PBF
Il a indiqué qu’ il s’agit d’un processus analytique essentiel permettant de produire une lecture indépendante, impartiale et factuelle de la situation politique, sociale, technologiques, économique, légales, sécurité ou humanitaires et environnementale du Niger. Cette démarche constitue une composante clé du plan de coopération entre le Niger et les Nations Unies, en offrant une vision prospective capable d’anticiper les risques et de saisir les opportunités susceptibles d’influencer le développement national d’ici 2030. L'objectif général assigné assigné à cette rencontre est de renforcer la capacité collective du Système des Nations Unies à identifier, analyser et prioriser les signaux faibles et tendances émergentes dans le cadre de l’ACP 2025. De maniere spécifique, l’atelier visait notamment à :Présenter la méthodologie de l’Horizon Scanning ;Examiner les signaux faibles issus de l’analyse contextuelle ;Prioriser les risques et opportunités émergents ;Proposer des mesures d’anticipation et de résilience pour exploiter les opportunités et atténuer les risques ;Renforcer la cohérence analytique inter-agences. À l’issue des travaux, plusieurs livrables ont été consolidés :Une liste structurée de signaux faibles identifiés ;Une analyse prospective des risques et opportunités susceptibles d’influencer le développement du Niger ;Une matrice de priorisation (impact/probabilité) pour hiérarchiser les dynamiques les plus déterminantes ;Des mesures d’anticipation et de résilience permettant de saisir les opportunités et d’atténuer les risques ;Des orientations claires pour la finalisation de l’ACP 2025, avec un alignement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Un exercice collectif et enrichissantCet atelier a constitué un moment d’échanges constructifs, rassemblant les expertises et perspectives des différentes agences du SNU.
L’intégration de l’Horizon Scanning marque une étape importante vers une planification plus prédictive, agile et cohérente, en alignement avec le UN 2.0 afin d’accompagner le Niger dans la construction d’un avenir plus résilient, inclusif et durable.Ecrit par Chamsia Chaibou, Assistante en Communication au PBF
1 / 5

Communiqué de presse
14 janvier 2026
Le Niger progresse vers une éducation accessible et de qualité
L’UNOPS a présenté plus de 38,000 équipements numériques acquis par le gouvernement du Niger dans le cadre du projet LIRE financé par la Banque Mondiale. Ces équipements visent à améliorer les espaces d’apprentissage et à renforcer la gestion du secteur éducatif au NigerCes équipements seront par la suite acheminés par le Ministère sur l’ensemble du territoire nigérien, au bénéfice des élèves, enseignants, encadreurs et cadres de conceptionNIAMEY, Niger - Dans le cadre du Projet Amélioration des apprentissages pour l'obtention de résultats dans l'éducation au Niger (LIRE), financé par la Banque mondiale, l’UNOPS a présenté à Son Excellence Madame la Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues, le 8 Janvier 2026, plus de 38,000 équipements informatiques acquis par le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues, à travers l'UNOPS. SE Dr Elisabeth Sherif, Ministre de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues, a effectuée une visite officielle aux entrepôts de l’UNOPS à Harobanda afin d’examiner le matériel informatique récemment réceptionné, d’un volume global excédant 77 tonnes. La visite s’est déroulée en présence des responsables centraux du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues, du Coordonnateur du projet LIRE, ainsi que des représentants de la Banque mondiale et de l’UNOPS.Le projet LIRE s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Gouvernement du Niger visant à améliorer l'accès des filles et des garçons à des environnements d'apprentissage propices à la réussite, ainsi qu'à des plateformes d'apprentissage diversifiées, contribuant de ce fait à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. En apportant des solutions flexibles aux défis rencontrés par le système éducatif, notamment la faiblesse des taux d’inscription et de réussite ainsi que le manque du matériel d’enseignement qualifié, cette initiative vise à renforcer le capital humain pour permettre à toutes et à tous de saisir l’avenir en toute confiance. En effet, grâce au financement de la Banque Mondiale, l'UNOPS soutient l'amélioration de la qualité de l'enseignement par le biais du projet LIRE depuis 2023. La phase initiale du projet, d'un montant de 6,3 millions de dollars, a été consacrée à la distribution de 7 000 tablettes équipées de batteries solaires et à la formation de 300 formateurs.
Cette nouvelle phase, dotée de 27 millions de dollars et lancée en 2025, permettra de fournir des équipements et accessoires informatiques en vue d'améliorer les environnements d'apprentissage et de renforcer les systèmes de gestion de l'éducation.Dans l’aire du temps, l’utilisation et l'intégration des technologies d’information et de la communication s'avèrent incontournables pour étendre l'accès à l’éducation, notamment dans les contextes où les infrastructures sont limitées ou les populations sont dispersées. Les équipements remis constituent ainsi des solutions concrètes pour surmonter les barrières socio-économiques et géographiques, permettant une diffusion plus large et équitable du savoir et garantissant la disponibilité des ressources pour améliorer les pratiques et les méthodes d’enseignement. Ces outils, notamment les ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs et systèmes de vidéoconférence, ouvrent également la voie à des méthodes d’enseignement plus interactives adaptées aux besoins des apprenants et aux prérequis de l'ère du numérique. Au cours de sa visite, Madame la Ministre a souligné que la modernisation du système éducatif par l'intégration du numérique constitue l'une des orientations majeures définies par les plus hautes autorités du pays. À cet égard, le matériel réceptionné sera progressivement acheminé vers les établissements scolaires, les structures décentralisées et les institutions de formation, au profit des élèves, des enseignants, des encadreurs et des cadres de conception.Hubert DOMAI MANDJODI, chef de bureau de l’UNOPS au Niger, a déclaré: «Investir dans les outils numériques représente un investissement dans l’avenir de l’éducation au Niger. Cette remise concrétise notre engagement collectif et notre partenariat en faveur du renforcement durable des capacités du système éducatif. Ces équipements contribuent à rendre l’apprentissage plus inclusif, plus interactif et mieux adapté aux besoins des enseignants et des apprenants, y compris dans les milieux ruraux, pour que personne ne soit laissé pour compte.»Tout au long de la durée de mise en œuvre de cette deuxième phase du projet, l'UNOPS continuera à gérer les ressources reçues de ses partenaires de manière efficace, efficiente, transparente et responsable, conformément à son expertise et son manuel des achats. Coordonnées pour la presse :Pour plus de détails sur ce projet et/ou pour interviewer un.e spécialiste de l’UNOPS, veuillez contacter Souhaila Merzougui, chargée de communication au bureau multi-pays de l’UNOPS pour l’Afrique de l’Ouest: souhailam@unops.org. À propos de l’UNOPSLa mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés et à aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. L’UNOPS aide les Nations Unies, des gouvernements et d’autres partenaires à gérer des projets et à mettre en place des infrastructures durables et des processus d’achats responsables de façon efficace. Pour en savoir plus, consultez le www.unops.org/fr et suivez l’UNOPS sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube et WhatsApp.À propos de la Banque Mondiale Avec ses 189 États membres, le Groupe de la Banque mondiale œuvre à la recherche de solutions durables pour aider les pays à mettre fin à la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée en fournissant des conseils, des services de financement et une expertise technique aux gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire.
Cette nouvelle phase, dotée de 27 millions de dollars et lancée en 2025, permettra de fournir des équipements et accessoires informatiques en vue d'améliorer les environnements d'apprentissage et de renforcer les systèmes de gestion de l'éducation.Dans l’aire du temps, l’utilisation et l'intégration des technologies d’information et de la communication s'avèrent incontournables pour étendre l'accès à l’éducation, notamment dans les contextes où les infrastructures sont limitées ou les populations sont dispersées. Les équipements remis constituent ainsi des solutions concrètes pour surmonter les barrières socio-économiques et géographiques, permettant une diffusion plus large et équitable du savoir et garantissant la disponibilité des ressources pour améliorer les pratiques et les méthodes d’enseignement. Ces outils, notamment les ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs et systèmes de vidéoconférence, ouvrent également la voie à des méthodes d’enseignement plus interactives adaptées aux besoins des apprenants et aux prérequis de l'ère du numérique. Au cours de sa visite, Madame la Ministre a souligné que la modernisation du système éducatif par l'intégration du numérique constitue l'une des orientations majeures définies par les plus hautes autorités du pays. À cet égard, le matériel réceptionné sera progressivement acheminé vers les établissements scolaires, les structures décentralisées et les institutions de formation, au profit des élèves, des enseignants, des encadreurs et des cadres de conception.Hubert DOMAI MANDJODI, chef de bureau de l’UNOPS au Niger, a déclaré: «Investir dans les outils numériques représente un investissement dans l’avenir de l’éducation au Niger. Cette remise concrétise notre engagement collectif et notre partenariat en faveur du renforcement durable des capacités du système éducatif. Ces équipements contribuent à rendre l’apprentissage plus inclusif, plus interactif et mieux adapté aux besoins des enseignants et des apprenants, y compris dans les milieux ruraux, pour que personne ne soit laissé pour compte.»Tout au long de la durée de mise en œuvre de cette deuxième phase du projet, l'UNOPS continuera à gérer les ressources reçues de ses partenaires de manière efficace, efficiente, transparente et responsable, conformément à son expertise et son manuel des achats. Coordonnées pour la presse :Pour plus de détails sur ce projet et/ou pour interviewer un.e spécialiste de l’UNOPS, veuillez contacter Souhaila Merzougui, chargée de communication au bureau multi-pays de l’UNOPS pour l’Afrique de l’Ouest: souhailam@unops.org. À propos de l’UNOPSLa mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés et à aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. L’UNOPS aide les Nations Unies, des gouvernements et d’autres partenaires à gérer des projets et à mettre en place des infrastructures durables et des processus d’achats responsables de façon efficace. Pour en savoir plus, consultez le www.unops.org/fr et suivez l’UNOPS sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube et WhatsApp.À propos de la Banque Mondiale Avec ses 189 États membres, le Groupe de la Banque mondiale œuvre à la recherche de solutions durables pour aider les pays à mettre fin à la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée en fournissant des conseils, des services de financement et une expertise technique aux gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire.
1 / 5
Communiqué de presse
28 novembre 2025
Le HCR et ONU Femmes signent un nouveau cadre de partenariat en appui au Niger en faveur des femmes et des filles affectées par les déplacements forcés
Niamey, le 27 novembre 2025- Le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés et ONU Femmes, l’entité des Nations unies pour l’egalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont signé un Protocole d’Accord (MoU) pour intensifier leur collaboration en faveur de l’égalité de genre, de la sécurité et de l’autonomisation des femmes et des filles touchées par les déplacements forcés, ainsi que des communautés hôtes. Ce partenariat s’inscrit dans les priorités nationales et les cadres internationaux tels que le Pacte mondial sur les réfugiés, l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité et le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (2023–2027).Plus de la moitié des 938 000 personnes déplacées de force au Niger sont des femmes et des filles. Une sur quatre est exposée à des risques accrus de violences faites aux femmes et aux filles, notamment les violences sexuelles, les agressions physiques, l’exploitation, le mariage précoce et le déni de ressources.« À un moment où les ressources humanitaires diminuent, ces chiffres illustrent l’ampleur des défis et la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires et du développement », a déclaré Fafa Olivier Attidzah, Représentant du HCR au Niger. « Nous devons travailler plus étroitement ensemble pour maximiser l’impact auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Unir nos forces avec ONU Femmes renforce notre capacité collective à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles réfugiées, déplacées et des communautés hôtes, à promouvoir le leadership féminin et à offrir des solutions durables en pleine cohérence avec les priorités du Niger, en coopération avec le système des Nations Unies et en étroite collaboration avec les autorités nigériennes. »Grâce à cet accord, le HCR et ONU Femmes travailleront de manière plus étroite pour renforcer la participation, la sécurité et le leadership des femmes et des filles touchées par les déplacements en vue de:Consolider les initiatives de prévention et de réponse aux violences faites aux femmes et aux filles ; Soutenir l’autonomisation économique des femmes et leur participation aux processus décisionnels communautaires ;Améliorer la collecte et l’utilisation de données désagrégées par âge, genre et diversité ; Mener des actions conjointes de plaidoyer et de communication pour faire progresser l’égalité de genre. « Lorsque l’action humanitaire et le développement placent les femmes et les filles au centre, chaque crise devient une opportunité de transformation », ajoute la Représentante d’ONU Femmes au Niger ai, Maïmouna Seyni Yaye.Le protocole d’accord (MoU) guidera des initiatives conjointes axées sur l’intégration du genre, le leadership féminin et le plaidoyer fondé sur des données factuelles. Il renforcera également la collaboration à travers des plateformes clés de coordination, telles que le Groupe Genre dans l’Action Humanitaire (GiHA), qui veille à ce que la planification dans tous les secteurs tienne compte des besoins spécifiques des femmes et des filles, et le Groupe de travail sur la Redevabilité envers les Populations Affectées (AAP), qui garantit que les voix des communautés orientent les décisions humanitaires.La signature intervient en pleine campagne des 16 Jours d’actions patriotiques contre les violences faites aux femmes et aux filles, soulignant l’engagement du HCR et d’ONU Femmes à soutenir les efforts nationaux et communautaires visant à mettre fin à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Ce partenariat stratégique permettra aux deux agences de conjuguer leurs expertises pour renforcer la cohérence des actions humanitaires, de développement et de paix au Niger, conformément aux engagements du Système des Nations Unies.Pour toute informations complémentairesHelen Ngoh Ada - Communications Officer UNHCR-Email: ada@unhcr.org
BOUBACAR SEYNI Fatimata- Communication Analyst UNWOMEN: email: fatimata.seyni@unwomen.org
BOUBACAR SEYNI Fatimata- Communication Analyst UNWOMEN: email: fatimata.seyni@unwomen.org
1 / 5
Communiqué de presse
28 août 2025
Le Niger et les Nations Unies lancent quatre programmes phares conjoints pour impulser transformation, croissance et cohésion sociale
Réunis au Centre International de Conférences Mahatma Gandhi, autorités nationales, représentants onusiens, diplomates, partenaires techniques et financiers, société civile et secteur privé ont officiellement lancé quatre programmes phares conjoints, visant à accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et à catalyser la transformation du pays à l’horizon 2030. Ce moment institutionnel fort répond à une double ambition : un alignement renforcé sur les priorités nationales du Niger, et une approche intégrée, inclusive et transformationnelle dans la mise en œuvre des interventions du Système des Nations Unies.Un processus stratégique né du dialogue et de la vision partagéePrésidée par le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, représentant Son Excellence le Premier Ministre, la cérémonie a réuni des membres du Gouvernement, des représentants diplomatiques, des chefs d’agences onusiennes, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de la société civile, du secteur privé et du monde académique. Ce large rassemblement multi-acteurs illustre l’ancrage national et international des programmes, ainsi que la dynamique de co-construction et de coresponsabilité qui a guidé leur élaboration. Dans son discours d’ouverture, la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Mme Mama Keita, a rappelé que ces programmes sont l’aboutissement d’un dialogue stratégique approfondi engagé avec les autorités nigériennes en 2024, dans un contexte régional marqué par des défis multidimensionnels. Elle a souligné la nécessité de passer d’une logique de fragmentation des projets à une programmation conjointe cohérente, lisible et structurée, capable de générer un impact tangible pour les populations. Ces programmes visent non seulement à renforcer l’efficacité de l’action publique et de la coopération internationale, mais aussi à transformer les défis en opportunités, en plaçant les communautés au cœur du changement. « Ces programmes phares sont le fruit d’un partenariat étroit avec le Gouvernement nigérien. Ils visent à transformer les défis en opportunités pour bâtir un Niger résilient et prospère. » Mama Keita Quatre axes pour transformer durablement le NigerChacun des programmes est porté par un ministère lead et co-construit avec les agences onusiennes concernées, illustrant une nouvelle approche de partenariat intégré et sectoriel, et couvrent les domaines stratégiques suivants :(1) la gouvernance socio-économique, visant à améliorer la transparence, l’efficacité des institutions et la gestion des ressources publiques ; (2) l’éducation et la formation, centrée sur l’accès équitable à une éducation de qualité, avec une attention particulière aux filles et aux zones rurales ; (3) la jeunesse et l’employabilité, axée sur la formation professionnelle, la création d’opportunités économiques et l’entrepreneuriat des jeunes ; et (4) la souveraineté alimentaire, mettant l’accent sur la résilience des systèmes agricoles, la production locale et la réduction de la dépendance aux importations. Une volonté politique affirmée et un appel à la mobilisationPrenant la parole au nom du Premier Ministre, M. Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, a salué cette initiative conjointe et réaffirmé la vision du Gouvernement :« Ces programmes traduisent notre vision commune d’un Niger souverain, où chaque citoyen peut réaliser son plein potentiel. »Sur le plan financier, la mise en œuvre des programmes phares conjoints pour la période 2025–2027 est estimée à 1,84 milliard de dollars américains, dont environ 7 % ont déjà été mobilisés par le Gouvernement du Niger et les agences des Nations Unies. Ces programmes, pleinement alignés sur les priorités nationales, s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) et des plans-cadres de coopération. Face aux défis multidimensionnels du pays, ils constituent une réponse structurée et ambitieuse, nécessitant une mobilisation accrue des partenaires bilatéraux, multilatéraux, des fondations et du secteur privé. La Coordonnatrice Résidente, Mme Mama Keita, a souligné le rôle central du financement du développement comme levier de transformation durable, appelant à un accompagnement plus prévisible, coordonné et soutenu pour assurer un impact concret sur le terrain.« L’engagement collectif est indispensable pour garantir un impact concret et durable sur le terrain. » — Mama KeitaUn engagement symbolique pour un avenir communLa cérémonie s’est conclue par une signature symbolique des chevalets, marquant l’adhésion officielle de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des programmes phares. Ce moment sollennel scelle non seulement l’engagement politique et institutionnel, mais cristallise également une vision partagée d’un Niger plus souverain, équitable, résilient et prospère, aligné sur l’Agenda 2030 et les objectifs de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS). Le discours de clôture du Ministre des Affaires Étrangères a mis en avant la convergence des visions autour d’un socle commun : celui d’un développement centré sur l’humain, porté par la solidarité, la responsabilité partagée et la redevabilité mutuelle.Ce lancement marque ainsi une étape décisive dans l’évolution du cadre de coopération entre le Système des Nations Unies et le Gouvernement du Niger, en ouvrant la voie à une programmation plus ambitieuse, plus lisible et mieux alignée aux priorités de l’État.Pour plus d’informations, veuillez contacter :Aminta Hassimi, Spécialiste en Communication - Bureau du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Niger : aminta.hassimi@un.org Site web : https://niger.un.org/fr - Twitter : https://twitter.com/SNUniger
1 / 5
Communiqué de presse
27 juin 2025
Le Niger se mobilise pour la 4ᵉ Conférence Internationale sur le Financement du Développement (FFD4) : vers des engagements concrets pour accélérer la mise en œuvre des ODD
Dans un environnement mondial marqué par la réduction des ressources concessionnelles, les réformes urgentes de l’architecture financière internationale et les défis sécuritaires croissants, le Niger souhaite renforcer son plaidoyer pour un financement plus équitable, prévisible et aligné sur ses priorités nationales. La réunion s’inscrit dans la dynamique du UN80, du Pacte pour le Futur et du Nouveau Cadre de Financement (Funding Compact), visant à doter les Nations Unies et leurs partenaires d’outils modernes pour soutenir les Objectifs de Développement Durable (ODD). Un engagement collectif pour des solutions durablesMme Ngoné Diop, Directrice du Bureau de la CEA en Afrique de l’Ouest, a mis en lumière les opportunités qu’offre l’initiative UN80, notamment en matière de gains d’efficacité, de gouvernance financière et de transparence. Le Pacte pour le Futur, quant à lui, appelle à une refondation des pratiques de financement pour les générations futures, avec un accent particulier sur la jeunesse, l’innovation, la paix et le développement durable. Des perspectives économiques contrastéesLors de son intervention, M. Moustapha Ly, Représentant Résident du FMI, a partagé un aperçu des performances économiques du Niger. Malgré une croissance projetée à 6,6 % en 2025 grâce aux exportations de pétrole brut et à la relance de l’agriculture, les contraintes budgétaires, la détérioration du secteur bancaire et les restrictions de financement continuent de peser lourdement sur la mise en œuvre des politiques sociales.Une mobilisation renforcée de la Banque mondiale pour soutenir les priorités nationalesPrenant la parole lors de cette rencontre, M. Hans Fraeters, Représentant Résident de la Banque mondiale au Niger, a mis en exergue les principaux axes d’intervention de la Banque mondiale, alignés sur les priorités nationales, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des infrastructures résilientes. À l’approche de la FFD4, il a insisté sur l’importance d’une coopération renforcée pour maximiser l’impact des investissements, soutenir les réformes structurelles et renforcer la résilience économique du pays dans un contexte régional complexe. L’état d’avancement des ODD : entre progrès et défisLa Représentante Résidente du PNUD, Dr. Nicole Kouassi, a dressé un état des lieux des ODD au Niger. Bien que des progrès soient notés dans les domaines de la gouvernance, de l’environnement et des partenariats (ODD 11, 13, 15, 16, 17), plusieurs indicateurs, notamment ceux liés à l’éducation, à l’accès à l’eau et à l’emploi, stagnent ou régressent. Le Niger a contextualisé 16 des 17 ODD et établi des mécanismes de suivi rigoureux. Toutefois, des inégalités persistantes et la fragilité des services de base nécessitent une action accélérée et des investissements ciblés. Une voix forte du Niger à SévilleÀ travers cette rencontre, le Niger affine sa position pour porter une voix forte lors de la FFD4. La Coordonnatrice Résidente, Mme Mama Keita, a rappelé l’importance de renforcer les partenariats et d’aligner les mécanismes de financement avec les ambitions nationales, tout en appelant à plus de solidarité envers les pays vulnérables.Contact presse :
Bureau du Coordonnateur Résident, Système des Nations Unies au Niger
Aminta Hassimi LarabouSpécialiste en Communication et PlaidoyerBureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations UniesCell : (227) +227 80 07 97 73. Email: aminta.hassimi@un.orghttps://niger.un.org/fr . https://twitter.com/SNU_niger
Bureau du Coordonnateur Résident, Système des Nations Unies au Niger
Aminta Hassimi LarabouSpécialiste en Communication et PlaidoyerBureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations UniesCell : (227) +227 80 07 97 73. Email: aminta.hassimi@un.orghttps://niger.un.org/fr . https://twitter.com/SNU_niger
1 / 5
Communiqué de presse
25 mars 2025
La Coordonnatrice humanitaire au Niger condamne avec indignation l’attaque meurtrière contre des civils dans la région de Tillabéri.
« Je suis profondément bouleversée par cette attaque d’une violence inouïe. Les populations civiles doivent être protégées en toutes circonstances. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et affirme le soutien indéfectible de la communauté humanitaire aux populations touchées par violence au Niger », a déclaré Madame Keita.Depuis des années, la région de Tillabéri subit les assauts récurrents des groupes armés, causant des déplacements massifs et une détérioration grave des conditions de vie des populations civiles. Ces violences exacerbent la vulnérabilité des communautés et entravent l’accès vital à l’aide humanitaire.« Le meurtre de civils est injustifiable. J’exhorte tous les acteurs à respecter le droit international humanitaire, à prendre des mesures immédiates pour protéger les civils et à traduire les responsables de ces actes odieux en justice », a ajouté Madame Keita.La communauté humanitaire, en collaboration avec le Gouvernement du Niger, reste pleinement mobilisée pour répondre aux besoins urgents des populations affectées, en respectant les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
27 novembre 2025
Ressources
22 septembre 2024
1 / 11